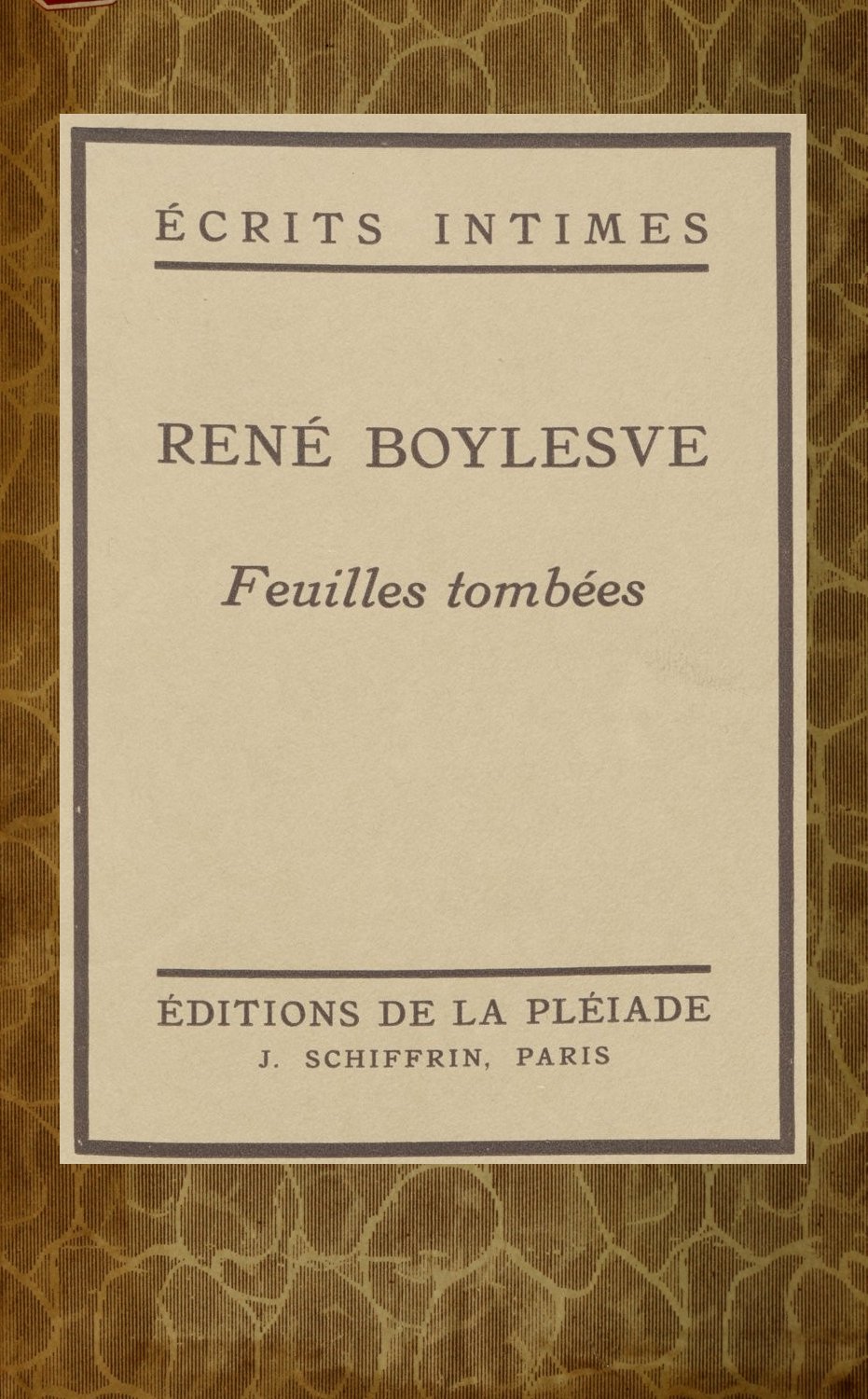
Title: Feuilles tombées
Author: René Boylesve
Editor: Charles Du Bos
Release date: July 28, 2023 [eBook #71287]
Language: French
Original publication: France: J. Schiffrin
Credits: Laurent Vogel, Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
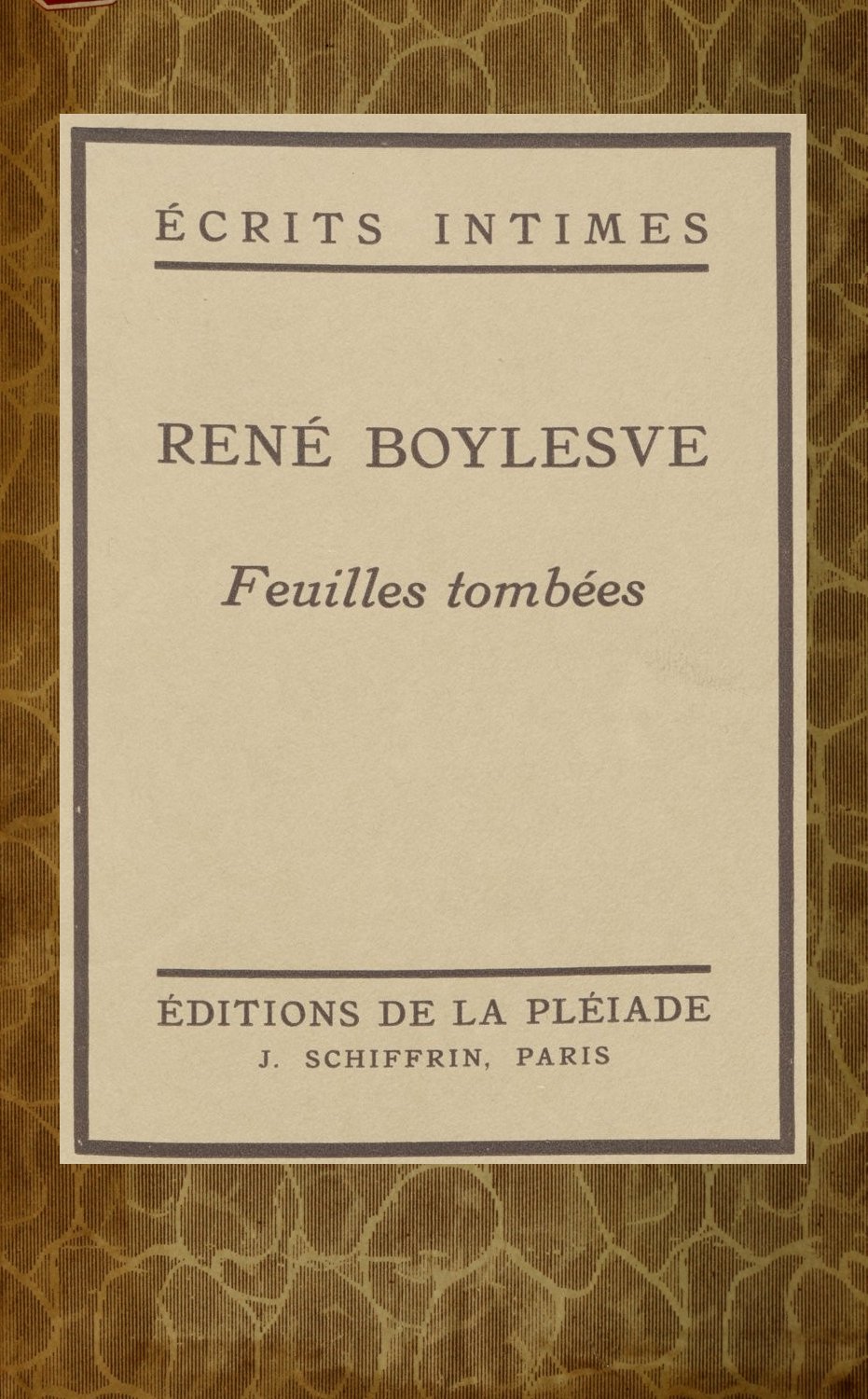
É C R I T S I N T I M E S
RENÉ BOYLESVE
ÉDITIONS DE LA PLÉIADE
J. SCHIFFRIN, PARIS
CE VOLUME
LE DEUXIÈME DE LA COLLECTION
L E S É C R I T S
I N T I M E S
A ÉTÉ TIRÉ SUR LES PRESSES DU
MAITRE IMPRIMEUR R. COULOUMA,
A ARGENTEUIL, H. BARTHÉLEMY
ÉTANT DIRECTEUR, LE DIX
JANVIER MIL NEUF CENT VINGT-SEPT,
A 2.600 EXEMPLAIRES,
DONT 100 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS
DE 1 A 100, SUR
HOLLANDE, ET 2.500 EXEMPLAIRES,
NUMÉROTÉS DE 101
A 2.600, SUR VÉLIN DU MARAIS.
LE PRÉSENT TIRAGE
CONSTITUE L’ÉDITION ORIGINALE.
É C R I T S I N T I M E S
COLLECTION PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE CH. DU BOS
RENÉ BOYLESVE
INTRODUCTION DE
CHARLES DU BOS
ÉDITIONS DE LA PLÉIADE
J. SCHIFFRIN, 2, RUE HUYGHENS, PARIS
————
MCMXXVII
{9}
Pour Alice René Boylesve.
«... la voix implacablement humaine de Montaigne, si cinglante pour ceux qu’a touchés l’accent de l’auteur des Pensées, son fils sublime: «Nous aurons beau faire... nous n’en sommes pas moins assis sur notre derrière...» Et pourtant lui-même avait dit, inspiré par l’amoureuse amitié un jour: «O la vile chose et abjecte que l’Homme, s’il ne s’élève au-dessus de l’humanité!...»
René Boylesve.
(Madeleine Jeune Femme.)
«... ne discernais-je pas déjà ces grandes voix, organes mystérieux, échos d’instruments inconnus, dont le timbre n’a pas d’équivalent parmi ceux de ce monde, dont la musique célébrait la dignité de mon origine, la sainteté de ma destinée, et entre ces deux relais, l’humble beauté de la vie que nous ne pouvons pas changer.
Idem.
«Ce sera mon œuvre posthume», disait Boylesve; et Jean-Louis Vaudoyer nous le rappelle en tête du récent et inappréciable livret: La Touraine, qui s’achève sur quelques fragments extraits de ce même dossier des Feuilles tombées. Avec l’autorisation de Mᵐᵉ René Boylesve, et grâce à l’accueil et au concours de M. Gérard-Gailly—tout ensemble le plus{10} scrupuleux et le plus diligent des exécuteurs littéraires,—il nous a été permis de consulter «les carnets, calepins et pages volantes» auxquels Vaudoyer fait allusion, et «où de sa petite écriture ferme et fine, Boylesve consignait au jour le jour ses rêveries, ses observations». En plein accord avec M. Gérard-Gailly,—et en attendant l’édition complète dont le temps n’est pas encore venu,—voici, pour l’anniversaire de sa mort, le premier accès à l’intimité de notre ami, et qui dès à présent nous livre sa vraie figure: une figure qui par toute son œuvre a su restituer en profondeur «les traits éternels de la France» parce qu’elle les portait tous en soi, et qu’à la différence de tant d’autres elle ne leur devait pas seulement ses dehors, sa parure, mais bien sa solidité, sa toute suffisante raison d’être.
⬛
«Mon œuvre posthume...» Non point avec hésitation, mais—par delà toute mélancolie—avec fière et sereine assurance, Boylesve articulait sans doute ces mots. Il était éminemment de ceux qui savent l’existence des deux registres, et qu’ici-bas de notre vivant le plus radical de nous-mêmes ne saurait s’exprimer. D’abord en vertu de cette représentation d’un lecteur possible à laquelle presque personne,{11} peut-être ne semble entièrement soustrait, et qui imprime, sinon toujours à la chose que l’on dit, en tout cas à la manière dont on la dit une déformation inévitable. (Moins que tous les autres les tenants de la sincérité nue n’y échappent—eux qui, du fait même de la sincérité se croyant quittes, finissent par perdre conscience du problème: la déformation alors se réfugie dans l’inconscient, et c’est de la meilleure foi du monde qu’ils sécrètent plus encore qu’ils ne fabriquent le sophisme.) Ensuite, même en admettant que l’on parvînt à s’exprimer sans réserves, resterait intacte la question de savoir si on en a le droit, non seulement vis-à-vis des autres envisagés tête par tête, non seulement vis-à-vis de «la société polie», création française s’il en fut, dont Boylesve comprenait, admirait, goûtait si fort la noble et complexe portée, dont la disparition (à laquelle il assista) lui fut un amer et toujours renaissant tourment, mais vis-à-vis de ce minimum d’ordre, de hiérarchie, de sens des valeurs, faute de quoi nulle civilisation n’est en état de subsister.
Se refusant d’une part à une «niaise» et d’ailleurs impossible «anarchie»[A], se refusant de l’autre à donner gratuitement offense, gardant vive en lui la conscience de ce qui est dû aux «honnêtes gens», qu’il{12} s’agisse de les «faire rire» ou de les faire réfléchir, Boylesve en ses écrits préparés pour la publication, tout en veillant avec grand soin à ce que la vérité essentielle ne se trouvât jamais lésée, tenait quelque peu en mains l’irréductible de son jugement[B]. Ceux qui ne se consolent pas de ne plus pouvoir retremper le leur dans ces stimulantes conversations où la hauteur de vue était toujours dictée par la moralité spéciale propre à «l’homme de l’esprit», auront souvent recours aux «conversations avec soi-même» que représentent Feuilles tombées. Par rapport à l’écrit, la liberté de l’entretien intime, celle—combien plus souveraine encore—du Journal, constituaient pour Boylesve ce second registre dont, dans la mesure même où s’aggrave sa perception de la vie, un être supérieur à partir d’un certain moment ne saurait plus se passer.
Hauteur de vue, ai-je dit, mais avant tout dans la sphère où les convictions intellectuelles étaient en jeu; pour tout le reste, dans l’entretien intime, de l’hospitalité la plus libérale, et de celle qui accroît celui qui en bénéficie sans entamer en rien celui qui la dispense.
«Il faut savoir entrer dans les idées des autres et{13} savoir en sortir, comme il faut savoir sortir des siennes et y rentrer.» Que de fois, en quittant Boylesve, me suis-je murmuré cette maxime de notre ami à tous deux, de Joubert: je n’ai rencontré personne qui plus instinctivement la sût mettre en pratique: au terme d’un long tête-à-tête où bien des points avaient été touchés, où bien des positions, parfois opposées ou simplement différentes, avaient été prises, tandis que Boylesve se levait pour reconduire l’interlocuteur, il semblait que l’on vît luire mieux que jamais l’aloi de son inaliénable intégrité. Les échanges, les traversées que favorisa cette spacieuse bibliothèque de la rue des Vignes (non sans analogie d’ailleurs avec une très confortable cabine de yacht)! Aujourd’hui que la piété de Mᵐᵉ René Boylesve et la vigilance de M. Gérard-Gailly nous l’ont maintenue vivante en la consacrant à sa mémoire, qu’à cette survie les écrivains contribuent en envoyant comme par le passé leurs livres, lorsqu’on y pénètre à nouveau, de ce clair asile d’un loisir studieux et peuplé, le mot d’ordre reste Æquanimitas. L’égalité d’âme—à condition que difficilement obtenue, elle fût elle-même une passion et une passion victorieuse,—il n’était rien que Boylesve prisât davantage: c’est lui demeurer fidèle que de surmonter l’inopérante tristesse et de poursuivre l’entretien. Qu’il me soit permis de séjourner un moment encore, ne fût-ce que pour l’illusion d’un dernier dialogue—un de ces dialogues où l’on souhaiterait tant pouvoir être contredit; où, ne pouvant l’être, l’on{14} n’a souci que d’apporter au disparu le seul hommage qui compte: celui de la compréhension.
⬛
Un bel artiste, vers la quarantième année, a pris le masque de son art même, et ses yeux sont profonds et pleins de choses dorées et de lumières, comme ces enfilades innombrables de pièces que l’on voit dans la glace d’un salon où une autre glace se mire. Vers la quarantième année... Boylesve avait quarante et un ans lorsqu’il me fut donné de faire sa connaissance. Formé déjà, éprouvé, avec cet air émouvant de qui se sent et se sait responsable, chargé du poids d’une expérience qui, bien loin de la courber, redressait encore sa haute taille, et qui dans ce beau visage, à la fois si distinct et si patiné, paraissait incrustée tel un ambre sans prix. Il avait encore la barbe de Schariar (que devait remplacer plus tard celle, à la française, des Clouet), et l’expression d’anxieuse mais inébranlable rectitude d’un ermite de Grünewald. Chaleur et gravité: qui n’a pas connu Boylesve, qui n’a pas été admis en son intimité, ne saura peut-être jamais de quelle persuasive plénitude peut être empreint l’alliage de ces deux attributs,—non point s’équilibrant ni se tempérant l’un l’autre, mais fondus jusqu’à l’indissociable. Tout l’être de Boylesve appartenait au registre du violoncelle; et parfois lorsque assis, ayant{15} écouté avec cette attention, cette immobile intensité qui paraissait alors subir, recueillir et capter le passage des ondes sonores, il rendait au juste moment sa large réplique étoffée, il semblait que l’on fût en présence de quelque Casals spirituel.
Oui, dès 1908 «il avait pris le masque de son art même». Lorsque je le rencontrai, j’étais tout subjugué par la découverte de Mon Amour—peut-être dans notre littérature le seul chef-d’œuvre du roman-journal, où le don des gradations est infini, mettant sa suprême délicatesse à se tout inféoder aux battements mêmes du cœur sensible,—d’un cœur qui tour à tour se comprime et éclate, qui épouse la ligne sinueuse du sentiment, la cerne de retouches, de «repentirs», mais avec l’unique objet d’y mieux encore adhérer, d’un cœur enfin qui toujours tremble de ne s’être pas à soi-même suffisamment fidèle...
Arriver à Boylesve en venant de Mon Amour, c’était sentir aussitôt à quel point il avait résolu le problème qu’un personnage de Henry James déclare le plus laborieux de tous: celui de «se ressembler à soi-même». Je songe à ces lignes de Mon Amour: Oserai-je dire à Mᵐᵉ de Pons qu’il est moins commun de reconnaître, entre un Père Éternel et un Fils, un peu gênés par les ailes éployées d’un Saint-Esprit, et entourés d’une légion d’anges et de bienheureux, la figure d’une femme du monde chez qui l’on dîne, et de ne pas la trouver comique?... En effet, laquelle de ces pareilles eût supporté une telle compagnie?...{16} Mais cela pourrait être pris pour un compliment, pour un certain compliment grave, et que je ne ferai pas, je le sens bien, parce qu’il est trop juste, ou parce que l’on sentirait trop que je le crois juste... Dans tous les ordres, Boylesve était l’homme de ce «certain compliment grave» qui figurait en son cas la seule alternative au silence;—à un silence non point hostile ni même hautain, mais bien au contraire d’une si attachante perplexité: pour combien d’entre nous, écrivains, dans le peu que nous faisions, n’était-ce pas notre aspiration la meilleure que de mériter que se rompent ce silence et cette perplexité? Jamais précipitée, ne se produisant qu’à la dernière limite (que l’on se souvienne de l’article où avec tant de probité il nous retrace les péripéties de la victoire que Proust remporta sur lui), mieux encore qu’une récompense, son approbation avait le poids d’une signature qui ne trompe pas.
Ses yeux étaient «profonds», et si je puis dire d’une profondeur légitime, celle où se reflète l’être tout entier: il est des yeux profonds qui leurrent, refuge dernier et poignant alibi de ceux qui, inégaux à leur vocation, déchus de leur innéité, devenus superficiels avec toutes les apparences de ne l’être pas, ne retiennent de profondeur que dans la détresse du regard dont ils enveloppent un intime naufrage. La profondeur de Boylesve,—c’est sur elle qu’il sied d’insister, dont il importe de caractériser la si originale et si composite nature; car là réside son massif{17} central: il n’a rien d’un «petit-maître», d’un «mineur»,—presque toujours mal à l’aise, gauche souvent, pesant parfois dans ces attraits de la surface où d’autres, qui ne le valent point, savent se montrer irréprochables[C]. Je revis ces années 1909 et 1910 où s’établit notre intimité. La Jeune Fille bien élevée venait de paraître, que devait suivre en 1912 Madeleine Jeune Femme—non certes le mieux venu, mais le plus substantiel, le plus inépuisable des ouvrages de Boylesve. Deux livres qui n’en font qu’un, ample symphonie intérieure où d’un bout à l’autre est perçu, en sa si sérieuse teneur, cet indestructible contrepoint qui est celui de la vie morale. Non seulement ils réinstauraient dans le roman français un élargissement que celui-ci n’avait plus connu depuis l’Education sentimentale; mais grâce à eux s’y introduisait une vertu plus rare encore, celle qui d’habitude lui demeure la plus étrangère. Comme on constate qu’un bassin s’emplit d’eau, je m’aperçus simplement que j’étais envahie. Telle est l’image qui vient spontanément à Madeleine dans le mémorable passage où elle prend conscience de son amour pour M. Juillet;—et seule cette image rend compte de la vertu à laquelle je fais allusion. Cet envahissement de l’émotion;{18} ce niveau soudain étale et aussitôt illimité; au sein de l’être même—et de lui jusque-là ignorée,—cette activité réfléchissante par où simultanément toutes ses puissances s’éprouvent décuplées,—c’est le constant apanage du génie de George Eliot, et c’est l’honneur de Boylesve—du Boylesve de cette symphonie intérieure—que d’être avec le Proust de Combray le seul romancier français au sujet duquel le nom d’Eliot puisse être mentionné[D]. Sur la page de garde de mon exemplaire de Le Meilleur Ami, une indication me rappelle que c’est dans les tout premiers{19} jours de janvier 1910 que je lus ce récit—qui porte, pour parfaite épigraphe, la parole de Heine: «C’est une vieille histoire qui reste toujours nouvelle, et celui à qui elle vient d’arriver en a le cœur brisé»; récit que par simple distraction sans doute Marivaux omit d’inclure dans son répertoire, et qui se pourrait intituler «le Jeu de la tendresse et de la cruauté». Et voici que j’arrive—ce qui nous ramène directement à Feuilles tombées—au numéro de Vers et Prose (octobre-novembre-décembre 1909) où parurent Promenades au dedans et au dehors, en tête duquel je retrouve inscrit: «Lu lundi 3 janvier 1910. En ai parlé avec Boylesve le même jour chez lui.» Que cette journée me reste présente! C’est que ces quelques pages m’apportaient la clef de la profondeur de Boylesve, et qu’alors même qu’on aime déjà on est tellement plus heureux de comprendre tout à fait ce que l’on aime. Qu’on m’excuse si je cède ici au besoin puéril de recopier cette petite note marginale que j’avais écrite en regard du passage suivant des Promenades: Je ne me révolte pas contre la mort possible; mais l’extinction de cette flamme sensible que j’ai toujours vue briller à côté de moi me terrifie comme la perte d’un de ces êtres—tels qu’il y en a—et qui nous sont plus chers que nous-mêmes.—«Au lieu d’à côté de moi»—notais-je—tout autre que Boylesve eût mis «en moi»: il eût frappé plus fort et moins juste.» Je visais ce scrupule—qui fut toujours le sien—à porter au compte, au crédit du dedans,{20} ces états précisément que lui-même plaçait le plus haut; et il n’y avait rien qu’il plaçât plus haut que la «flamme»: souvenons-nous de la phrase sur laquelle s’achève la préface pour la réimpression de Sainte-Marie des Fleurs: Mais au-dessus même de la forme achevée et pure, s’élève parfois une certaine flamme qui attire mieux que les contours irréprochables, non pas sans doute qu’elle soit plus belle, mais simplement parce qu’elle brûle...
Je ne me rappelle plus les détails de l’échange que nous eûmes après que je lui eus exprimé mon admiration et ma gratitude ce lundi après midi,—un des lundis hebdomadaires de la rue des Vignes qui jusqu’à la guerre constituaient un des plus précieux points de ralliement de notre petit groupe d’alors. Souvenirs d’un Jardin détruit, nous sommes quelques-uns pour qui ce titre de Boylesve distille une mélancolie, fait lever une nostalgie indicibles; quelques-uns qui, tels l’héroïne de Tu n’es plus rien, nous remémorons «cette période de notre vie qui semble être jouée sous nos yeux comme un acte». Bien plus que la guerre, c’est l’après-guerre qui nous permet de redire le mot de Talleyrand, car nous avions connu «la douceur de vivre», puis la guerre nous avait montré—demandons à notre Drouot (qui aimait et ornait ce Jardin) l’expression qui convient—ce que sont et ce que peuvent les «âmes avides de grandeur»: il a fallu l’après-guerre pour nous apprendre que la littérature, elle aussi, pouvait être—comme le dit{21} Stendhal de la réputation de Métilde à Milan—«hautement déshonorée». Que nous en étions encore loin! Celui qui n’a pas vécu parmi des écrivains avant la guerre ne peut même pas mesurer l’écart. Tandis que les hôtes se succédaient nombreux,—et avant que les intimes se resserrassent pour poursuivre l’entretien jusqu’au dîner,—je revois Boylesve circulant à travers les pièces, et s’appliquant, sans se départir de sa retenue, à se mettre au niveau de chacun. A ses yeux, l’homme véritablement grand était celui qui savait proportionner sa stature aux circonstances, et même, le cas échéant, la réduire,—faisant tout involontairement sentir sa grandeur dans la grâce même avec laquelle il la dépose, en dépose ce qu’il faut pour pouvoir mieux offrir ce qui sied. Qu’il est élégant à un homme vraiment grand de ne rapporter des sommets qu’un air plus pur! Lorsque les hommes consentent, en faveur d’une femme intelligente, mais rien que femme, à présenter d’une façon courtoise les fleurs de leurs connaissances, de leur jugement et de leur goût, le joli jeu pour elle de les accueillir, de paraître les trier dans sa main, et de montrer, après, qu’elle en est toute parée, embellie! Un jour que je laissais entendre à Boylesve à quel point il me paraissait ressembler au Guglielmo Santi que nous dépeint ce passage de Mon Amour, par une réponse toute sienne, à la fois détournant l’entretien de lui-même et le maintenant sur le sujet qui lui était cher, il me prêta son édition originale des Conversations de Méré.{22}
Méré, le miroir de la société polie, l’ami de Pascal, le prototype des «fins qui ne sont que fins», et dont les grands justement ont toujours à cœur de saluer la délicatesse;—Méré à la mémoire de qui Henri Bremond, à l’issue du dîner que donna naguère en son honneur la Revue Critique des Idées et des Livres, adressait une louange si pertinente et si opportune. Boylesve et Bremond: j’eus la joie de les mettre en rapport, de les voir s’apprécier, se concerter parfois Ile Saint-Louis pour protéger les lettres en haut lieu. Aujourd’hui c’est Bremond qui, presque seul, veille à ce que le Jardin de la «Société polie» ne soit pas entièrement détruit comme l’autre. Confiants en sa fermeté ductile, revenons tout à notre ami.
⬛
Oh! comme il faut que je me sache seul pour bien sentir, c’est-à-dire pour sentir si fort que la traduction rigoureuse en paraîtrait insensée!
Cet aveu dénude, sous sa forme originelle, native, la profondeur de Boylesve: une sensibilité si ardente que sa directe, sa pleine, sa toute fidèle expression eût présenté le caractère même de la folie. Mais c’est qu’en effet de telles sensibilités sont folles—ainsi que le discerna le premier Paul Bourget pour l’homme qui est chez nous la suprême incarnation de cette{23} lignée: «Mais, c’est là le trait dominant d’Henri Beyle, et le plus méconnu, aucune âme ne fut douée par la nature d’une sensibilité plus folle, plus incapable de se dominer: «J’ai toujours été comme un cheval qui galope après son ombre...» Quand le cheval est de race française,—et de bonne race,—il se pose alors pour lui un bel et difficile problème, celui avec lequel fut toute sa vie aux prises Stendhal qui, se décrivant sous le pseudonyme de Roizard, disait: «Les yeux exprimaient les moindres nuances de ses émotions. Et c’est ce qui mettait son orgueil au désespoir.» Problème que je ne veux pas rendre plus exceptionnel qu’il n’est—car, de passagers accès de folie de la sensibilité, beaucoup y peuvent être sujets—mais qui précisément ne développe toute sa gravité que lorsqu’il s’agit, non plus d’accès, mais presque d’un continuum intérieur, lorsque au lieu de constituer la norme, les «intermittences» deviennent l’exception. En ce sens, je crois bien que depuis Stendhal, Boylesve est le Français qui aura eu le plus à faire pour maîtriser son propre galop. La perfection avec laquelle il y parvint, avec laquelle même il veut que Français, nous aussi y parvenions, ne doit pas nous induire en erreur. L’homme qui me parle à brûle-pourpoint de ses «sensations» me gâte quelque chose, l’idée que j’avais de sa discrétion, de son tact ou l’idée que j’avais des choses qu’il dit sentir. J’aime qu’il me montre qu’il a vraiment senti, mais par quelque détour ingénu, ou bien à travers un voile tendu habilement:{24} j’aime qu’il se laisse surprendre ou bien qu’il dise: «Ce n’est rien, ce n’est rien», quand on voit qu’il pleure. Jean-Louis Vaudoyer a bien raison de nous ramener à ce texte de Mon Amour où se trouve concentrée toute la pudeur de Boylesve: son fier idéal d’une discrétion toute civilisée, et aussi son respect infini pour les sources de l’émotion, sa propension à toujours les maintenir séparées de leurs effets, pures de toutes les atteintes que pourraient leur infliger nos faiblesses individuelles; pourtant, dans la poignante délicatesse du trait final, si l’homme dont «on voit qu’il pleure» dit, et doit dire, «ce n’est rien», n’est-ce pas aussi, n’est-ce pas surtout que s’il disait quelque autre chose, il rejoindrait la folie,—alors que c’est le calme qu’il lui faut conquérir, et conquérir au point de se pouvoir dans une certaine mesure à lui-même faire illusion. Qu’elle retentit avant la petite phrase de Le meilleur Ami: «Pour moi-même comme pour tout le monde, ah! que j’étais donc un homme calme!...» Qui saura dépeindre le calme propre aux vrais passionnés, à ceux dont la passion est l’état permanent, une passion où l’amour figure le noyau, mais qui peut aussi déborder l’amour même et qui de toute façon est vouée à de multiples transferts? Passionné, Boylesve l’était avant toute autre chose, et en tout: jusque dans son instinct de justice—le plus impérieux peut-être que j’aie connu à un écrivain—, jusque dans la hauteur même de son jugement, la passion se décelait présente, et il eût été moins juste sans elle.{25}
J’aime mieux la forme des choses qu’un visage: elle sait me plaire et elle ne me juge point;—surtout, elle ne m’a jamais dit: «Tu exagères!...» Brève notation, mais, pour comprendre Boylesve, singulièrement riche de portée. A ceux en qui, si l’on peut dire, la passion préexiste aux passions, «la forme des choses» (mais dans le cas de Boylesve il faut prendre le terme en son acception la plus étendue, ajouter à la nature elle-même tous ces ouvrages qui, faits de mains d’homme, ont fini par la rejoindre) offrira toujours l’unique réceptacle tout à fait adéquat; pour lui, de même que pour Stendhal, «les paysages étaient comme un archet qui jouait sur son âme», et surtout, à cette âme, seule la «forme des choses» sait répondre, à cause de son infinie consonance informulée: en son sein se résorbe, devant elle expire la possibilité du toujours imminent «tu exagères». Or par ce «tu exagères» Boylesve traduit, non point certes la pire souffrance de la sensibilité folle, mais celle à laquelle, dans «la vie de relations», elle est sans cesse et tout inévitablement exposée, chaque fois qu’émergeant de l’incandescent foyer intérieur où elle vit de se consumer,—et émergeant tout enveloppée encore de ses chaleureuses vapeurs—, elle est amenée à communiquer: elle sait bien qu’elle «n’exagère pas», mais elle sait aussi qu’il est impossible qu’elle n’ait pas l’air «d’exagérer».{26}
Telle m’apparaît ici la profondeur «subjective»;—et que par ailleurs l’œuvre de Boylesve doive tant de sa solidité à une profondeur de nature tout autre, de nature presque inverse, à la profondeur «objective»[E], marque chez lui le rétablissement qui constitue peut-être son plus insigne exploit. Car, la profondeur subjective étant donnée, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’une profondeur objective en naisse: à proprement parler ce n’est jamais d’elle qu’elle naît: bien au contraire, elle se produit, se pose, s’affirme en regard d’elle comme le seul barrage salutaire, la valeur de contrepoids. Le passage à l’objectif, pour les grands subjectifs ce fut toujours le problème crucial, et qu’un très petit nombre d’entre eux s’est montré capable de résoudre. Pour nous en tenir à la France—et en laissant hors de cause Stendhal qui échappe à toutes catégories et le Constant d’Adolphe,—ce passage, Rousseau n’a jamais pu l’accomplir, et par le désarroi dont témoigne son contact avec autrui Maine de Biran fut favorisé de le pouvoir éluder, comme peut-être à cet égard Guérin lui-même doit beaucoup à sa possession du génie mythique,—et l’on sait assez d’autre part au prix de quelles ablations pratiquées sur son être même Flaubert obtint son triomphe «objectif».{27} Si Boylesve sut opérer le rétablissement à tel point que ceux qui ne l’ont pas étudié d’assez près peuvent douter parfois s’il y avait rétablissement à opérer, ne pas appréhender toute la portée de l’intime enjeu ici engagé,—c’est en vertu de son sens incomparable du général, et de la grandeur incluse dans le général comme tel; et, plus profondément encore, c’est parce que ce sens était poussé si loin qu’il s’accompagnait chez lui d’une forme d’émotion très particulière, et que je voudrais appeler: l’émotion du général. Nous touchons ici le point: c’est grâce à une émotion que le passage, que le rétablissement s’opèrent; d’où leur validité, s’il est vrai, comme le promulguait «la sagesse lyrique» de Barrès, à la veille même de sa mort, que «rien n’existe dans l’humanité sans ce jaillissement primitif, dont nul être n’est incapable, et qui d’abord doit être obtenu, puis canalisé, et discipliné». Le 25 août 1889, le Boylesve de la vingt-deuxième année notait dans son Journal: «Une journée d’assez curieuses émotions. Je suis retourné à Poitiers que je n’avais pas vu depuis huit ans», et après avoir, dans le mode pré-proustien que je signalais plus haut, décrit ces «assez curieuses émotions», passant à la ligne il ajoute: C’est une supériorité peut-être de la sensibilité sur l’intelligence, que la sensation se réjouisse des sensations différentes éprouvées, tandis que l’idée nouvelle anéantit et méprise toute idée antérieure opposée[F].{28} Vue que Boylesve enregistre, se propose, avec la prudence, la modération qui lui sont propres, toutes les fois justement où l’idée générale vient à poindre; mais le constat n’en est pas moins d’une netteté qui ne laisse rien à désirer. Très différemment de ce qui se passe dans la zone de l’exaltation, mais de façon tout aussi indubitable, dans le domaine du général c’est la sensibilité encore qui est l’artisane,—oh! non plus en sa folie, mais tout au contraire en sa perception de l’attache et de la dépendance. Se sentir rattaché et dépendant; appartenir, dans l’acception absolue de ce terme—un des plus augustes et des plus insondables qui soient; être rattaché, dépendre et appartenir d’autant plus sûrement qu’en son foyer originel, lointain, surélevé, la nature du premier moteur reste toute mystérieuse,—voilà ce qu’il faut entendre par l’émotion du général, et ce que Boylesve mieux que quiconque a su rendre sensible. A cet égard il n’est point de courbe plus belle ni plus instructive que celle qui, partant de la fin de l’Enfant à la Balustrade, où, en un implorant appel, l’enfant se tourne une dernière fois vers la statue d’Alfred de Vigny, conduit aux pages intitulées «Le Prestige de l’Ordre» sur lesquelles se terminent les Nostalgiques.
De ma balustrade, je regardai encore une fois cet être inconnu de tous et dominant tout le monde de sa mine altière. Il restait étranger à nos rumeurs, à nos disputes, à nos bassesses. Il paraissait désespéré, et pourtant calme. Était-ce à cause de ce qu’il voyait à{29} ses pieds? était-ce à cause de ce qu’il voyait au loin? De son piédestal, voyait-il les hommes mieux que nous? Voyait-il Dieu? Ne voyait-il rien?
M. le curé m’avait dit en m’expliquant les auteurs anciens:
«Mon enfant, les pensées forment un jeu de patience merveilleux: il s’agit de trouver entre elles un certain ordre. Tant que cet ordre n’est pas trouvé, elles clochent entre elles et nous font mal, quand vous le tenez, vous voyez Dieu.»
Oh! comme j’essayais de mettre de l’ordre dans mes pauvres pensées; mais j’étais trop jeune... Et personne ne m’aidait.
La nuit était presque venue, j’eus moins de honte à commettre une extravagance. Je ramassai dans l’ombre tous mes beaux désirs d’enfant, écornés déjà aux réalités de la vie, et, au risque d’être pris pour un insensé si quelqu’un m’entendait, je mis mes mains en porte-voix sur ma bouche, et criai au poète:
—Que voyez-vous? que voyez-vous? vous qui avez l’air d’être au-dessus de nous[G]!
Si je disais que tous mes maîtres en rabat blanc étaient des êtres exquis et dignes d’être mis en niche ou sur les autels, cela ferait plaisir, je présume, à{30} beaucoup de lecteurs, et je semblerais un moins mauvais esprit. Mais je ne veux rien embellir ni qualifier meilleur qu’il ne me semblait être: tous, malgré le respect dont ils étaient dignes, ne m’inspiraient point admiration parfaite et amour. Eh bien! quand tous ces Frères,—ceux que j’aimais et ceux que je n’aimais pas,—étaient réunis à leur longue table, le Frère Directeur au milieu d’eux, sous le grand Christ du réfectoire, formant en leur assemblée comme une vaste Cène digne du pinceau d’un Vinci; quand, devant tout le pensionnat debout, le Directeur disait le Benedicite ou les «Grâces»; quand, surtout, chaque matin, dans la pénombre sépulcrale de la chapelle—où, à cette époque-là, j’assistais à la messe avec ennui, ayant mal au cœur pour m’être levé trop tôt et pour être encore à jeun—nous voyions se lever de nos bancs nos maîtres et s’avancer d’un pas lent, les paumes des mains unies, les doigts allongés dans cette attitude de prière propre aux pieux donateurs sur les vitraux du moyen âge et aux statues agenouillées des morts sur les tombeaux, puis recevoir la communion, des mains de l’aumônier, et revenir enfin tout contre nous, les yeux clos pendant plusieurs minutes, toute la vie du corps arrêtée par une méditation singulière qui semblait pour un moment les arracher à ce monde... eh bien! oui! leur compagnie entière nous inculquait un sentiment et des dispositions générales qu’aucun des exemples du monde n’a été, depuis lors, assez puissant pour égaler.{31}
Je n’étais ni bien disposé, ni à mon aise; je n’étais capable que de bien petites réflexions; et cependant, à maintes reprises, a couru dans mon dos ce frisson qui ne me trompe pas et qui veut dire qu’un des esprits ailés que j’imagine présider à ma vie, passe au-dessus de moi...
On n’oublie point ce genre d’émotions; il remue, pétrit et modèle notre chair. Si je veux, en un clair langage, exprimer ce qu’il en résultait pour mon cerveau d’enfant, ce n’était pas encore une inclination religieuse. A cette époque-là, je me souviens que la sensibilité religieuse n’existait à aucun degré chez moi. J’étais touché, et même ému profondément par la vue d’une petite société, dont je faisais partie, où tout se passait dans un ordre impeccable, où un mélange d’autorité forte et de douceur empêchait que personne fût sérieusement mécontent, et où il apparaissait, même à mes sens puérils, que la source de l’ordre provenait d’un je ne sais quoi inexplicable, probablement très grand, imposant et mystérieux[H].
Pages qui—par la lenteur de la montée, la puissance cumulative, je ne sais quelle majesté intime en vertu de laquelle c’est de l’élément concret que tout naturellement semble se dégager l’élément supra-individuel—n’ont d’égales que chez Proust ou dans les «Écrits Autobiographiques» de Henry James; mais entendons la contre-partie:{32}
Et encore, tout cela ne se débrouilla-t-il définitivement que par la vertu du contraste.
Lorsque aux vacances du Jour de l’An, je débarquai dans ma famille, je me trouvais être devenu un autre enfant.
La paix régnait à la maison et dans Beaumont pour le moment; mais j’estimais que rien n’y était cependant comparable à cette magnifique ordonnance du Pensionnat des Frères. Autour de nous, chacun tirait à soi, allait à sa guise, fomentait, en définitive, des éléments de discorde. J’entendis raconter des histoires locales qui prouvaient que la vie libre, au grand air, jadis tant prisée par moi, n’allait tout de même pas sans offrir des inconvénients. Je trouvai que le dimanche, à la messe, tout le monde se tenait de manière à mériter des «privations de sortie». N’y avait-il pas des personnes, jusque dans ma famille, qui, à la messe, n’allaient même pas! Ce manquement, qui ne m’eût pas été apparent trois mois plus tôt, me scandalisa. Par-dessus tout, il me semblait que chacun était préoccupé de mesquineries, parce qu’un lieu idéal de ralliement manquait à ces butinements d’abeilles ou à ces promenades de fourmis. Dès avant l’internat, cette dernière remarque, assez conforme à ma nature, était néanmoins renforcée par mille détails.
Comme il arrive trop aisément aux gens de notre pays, témoin successivement de deux sortes de vie, je n’admettais que l’extrême en chaque genre.{33}
J’ai peine à croire aujourd’hui que mon Poète, Alfred de Vigny, dont la statue trônait au milieu de la place publique, mon cher Poète, jadis mon modèle et la dernière expression du Beau et du Bien, me paraissait désormais manquer de prestige! Que faisait-il là, en effet, avec ses airs de fierté, s’il n’était seulement pas capable d’organiser autour de lui un ordre sublime[I]?
⬛
«Comme il arrive trop souvent aux gens de notre pays... je n’admettais que l’extrême en chaque genre.» L’extrême, oui, mais en chaque genre; et ici nous en avons déjà rencontré trois: la folie de la sensibilité, l’émotion du général, l’individualisme retranché d’un Vigny sous sa forme la plus radicale: celle de l’Ordonnance du Docteur-Noir. Or la grandeur propre au Français profond, c’est d’occuper, de tenir, de fortifier même l’une contre l’autre plusieurs positions extrêmes. Boylesve était un tel Français profond: strictement Français, mais Français intégral, abritant au sein de son être la totalité de notre patrimoine, établi vis-à-vis de cette totalité dans une relation tout{34} analogue à celle de l’humaniste vis-à-vis du monde gréco-latin.
Et cependant, dans le temps même où il occupe, tient et fortifie ces positions extrêmes, le Français profond n’est tout à fait digne du titre que si sa faculté logique—ce génie spécial aux parties hautes de notre race—éprouve avec une lucidité entière leur irréductible contradiction. Boylesve l’éprouvait au plus vif,—avec cette indignation, presque cette véhémence contractée qui est celle du clairvoyant en présence de ceux qui ne voient point, ou qui ne veulent point voir: l’indignation, la véhémence se contiennent parce que le clairvoyant a tôt fait de comprendre que, dans l’ordre moral, l’opération de la cataracte est impraticable, ou sujette à des suites pires que le mal même; mais chez ceux qui vivent cette contradiction au point d’en devenir les conscientes victimes, au sein même de la douleur immédiate, de la réaction organique, une douleur d’une autre sorte se fait jour, toute pure celle-là, désintéressée et comme décantée: la douleur de la logique atteinte, froissée,—et d’autant plus gravement que c’est alors la logique de l’être intérieur lui-même qui est en jeu. Je songe à l’entrée, puis à la reprise du thème capital de La Jeune Fille bien élevée,—thème qui sous-tend le livre tout entier. Il s’agit de modérer la piété de Madeleine, jugée au couvent même excessive. Mᵐᵉ du Cange me dit qu’il{35} fallait en toutes choses avoir de la mesure, «même dans la perfection», ajouta-t-elle.
Je ne comprenais pas cela. Qu’il fallût s’arrêter, même dans le plus beau chemin, voilà qui dépassait mon entendement. J’osai objecter à Mᵐᵉ du Cange:
—Mais, madame, et les saints?...
—Les saints, dit-elle, il faut les tenir pour nos modèles; mais c’est une présomption orgueilleuse que de vouloir atteindre à leur perfection; sachons rester modestes...
Les excès qu’on me reprochait me rappelèrent ceux dont on avait fait grief à mon pauvre papa, de son vivant, tout au moins. Lui aussi, il avait été trop loin: il avait perdu le sens de la mesure; il avait donné sa fortune pour sa cause, c’était «un emballé», comme disaient de lui ses beaux-parents. Depuis sa mort, il est vrai, son «emballement» passait pour admirable. Pour les saints, il devait en être de même... On les avait sans doute traités d’insensés, du temps qu’ils accomplissaient cela même qui, après coup, les avait mis sur les autels.
De si grandes vertus, il ne convenait pas de les imiter tout à fait...
Ah! cet incident avec l’aumônier et Mᵐᵉ du Cange fut une de mes plus vives contrariétés de jeunesse. J’étais tentée de m’écrier, comme papa naguère: «Vous n’êtes pas logiques! La sainteté, l’héroïsme, la vertu, qui sont le fond de ce qu’on nous enseigne, eh bien! eh bien! il ne faut donc les atteindre que{36} dans une certaine mesure? Ce sont des mots dont la beauté nous fouette, et en pleine course, est-il possible vraiment qu’il nous faille nous arrêter tout à coup?... Oh! que voilà bien l’accent d’une fille de France, vraie, sérieuse, en qui l’héroïsme intime et la logique ne font qu’un, que les exigences de l’esprit non moins que le besoin de netteté morale et les insatiables aspirations du cœur portent à ne s’arrêter point «en pleine course», à aller «jusqu’au bout»! Et, à la veille du mariage de raison dont elle nous dit qu’elle a «l’impression d’y être amenée comme une bête de somme à l’abattoir», mais que déjà au fond d’elle-même elle a accepté, pour sauver peut-être, en tout cas pour satisfaire les siens, la voix de cette même Madeleine résonne plus basse, plus chargée, plus significative encore, tant—et si Française aussi en cela—elle a le sentiment d’être l’humble lieu et tout occasionnel d’un débat qui la dépasse: Contradiction étrange et que personne n’examine avec franchise! On nous met à genoux devant la beauté, le divin, l’absolu; puis l’on nous dit: Tout doit céder devant la réalité. On nourrit, on excite, on exalte nos rêves; et l’on nous donne pour avis: N’écoutez pas les chimères. Nous voyons bien que l’amour est au fond de la religion, de la littérature et de la musique dont on nous a imprégnées jusqu’aux moelles; et, quand le cœur et la chair sont mûrs, il n’y a qu’une voix pour nous crier: «Il ne s’agit pas d’amour; le mariage!»{37}
«Contradiction étrange», oui, mais étrange surtout par l’universalité de son application s’il est vrai qu’elle constitue la charnière même de cette vie dont, au terme de son expérience de jeune femme, Madeleine nous dit que «nous ne pouvons pas la changer», et qu’en cela même réside son «humble beauté». Cette contradiction, personne ne l’a «examinée» avec plus de «franchise» que Boylesve, parce qu’elle était inscrite et comme nouée dans les données mêmes de sa nature. Elle forme la substructure de son œuvre tout entière. Il existe un grand dialogue dont il nous faut souhaiter qu’il dure aussi longtemps que notre race, car il s’en dégage la musique la plus compréhensive et la plus solennelle que le génie français ait fait rendre à l’instrument qui lui est propre: le dialogue Montaigne-Pascal. Un Français est profond dans la mesure où, à son rang, il sait maintenir ce dialogue vivant en lui. Si à Montaigne, un Boylesve doit l’indispensable rappel biologique, il lui doit aussi ce besoin «non seulement de se définir, mais encore de se classer» dans lequel Ramon Fernandez voit à juste titre la valeur, la portée spécifiques de Montaigne[J], et auquel Fernandez lui-même aujourd’hui adjoindrait{38} un besoin connexe: le besoin «d’être jugé»[K]. Mais le Montaigne de «l’Amoureuse amitié», celui de: «O la{39} vile chose et abjecte que l’Homme s’il ne s’élève au-dessus de l’humanité!» n’est ni l’essentiel ni le dernier Montaigne. Celui qui détient «la voix implacablement humaine» que Boylesve dénomme «si cinglante», c’est le Montaigne des pages finales du final chapitre des Essais. Pages qui sont et demeureront à jamais, la charte de l’humanisme le plus ample mais en même temps le plus strict; où éclate—combien «cinglante» en effet si l’on songe à la coutumière modération montaignesque—l’apostrophe d’expresse déclaration: «Ils veulent se mettre hors d’eux et eschapper à l’homme. C’est folie; au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bestes; au lieu de se hausser, ils s’abattent. Ces humeurs transcendantes m’effrayent, comme les lieux hautains et inaccessibles; et rien ne m’est à digerer fascheux en la vie de Socrates que ses ecstases et ses demoneries, rien si humain en Platon que ce pourquoy ils disent qu’on l’appelle divin. Et de nos sciences, celles-là me semblent plus terrestres et basses qui sont le plus haut montées»; oh! sans doute, aussitôt après, avec cette phrase qui, au choix très délibéré des termes, emprunte une si claire et tout inépuisable signification: «C’est une absolue perfection, et comme divine, de sçavoyr jouyr loiallement de son estre», l’on regagne les champs ensoleillés où, venue à mûrissement, s’éploie la récolte de toute une vie; mais, en dépit de l’aménité conclusive, comme l’on sent qu’à tout le reste vient d’être dit: «Ote-toi de{40} mon soleil.»—A quoi, «éclatant à son tour aux esprits», fixant sous sa forme définitive la charte de la surnature et (en une acception toute religieuse mais la plus vaste du mot) celle de la surhumanité, Pascal riposte éternellement avec l’homme «plein de besoins», l’homme «produit pour l’infinité», l’homme enfin «qui passe infiniment l’homme».
⬛
C’est parce que Boylesve n’a cessé de poursuivre intérieurement ce dialogue[L] qu’il garde une si émouvante et si exemplaire vertu pour ceux qui, comme lui, aujourd’hui, sont à la fois fidèles et infidèles à Montaigne, qui ne peuvent ni l’abdiquer ni de lui se satisfaire; et qui d’autre part, remués, retournés, travaillés en tous sens par «son fils sublime», en sont encore à attendre la visitation. Dans l’attente, ils n’ont qu’un recours, solide, il est vrai, celui auquel on devine que Boylesve lui-même recourut, et qu’il plaça en épigraphe à Madeleine Jeune Femme, l’indestructible phrase de Descartes à la princesse Élisabeth: «Tout notre contentement ne consiste qu’au témoignage intérieur que nous avons d’avoir quelque perfection.»
Charles Du Bos.
Décembre 1926.{41}
Pourquoi suis-je hanté par le souvenir d’une fin de journée à Longueville, dans le petit salon de Mᵐᵉ du H...? Il y a vingt ans que ce soir-là est passé, et il n’a rien eu de remarquable. Certaines heures qui s’écoulèrent presque inaperçues, dorment en nous, longtemps, pareilles à la Belle au Bois, et s’éveillent, un matin, toujours jeunes, à l’appel de quelque prince Charmant.
C’était un soir d’août: la fenêtre était ouverte sur les Quinconces où s’était tenu le bruyant marché aux légumes; l’ombre des ormes faisait une nuit prématurée, tandis qu’en bordure de la place les rues pavées semblaient blanches. Par un accord secret des paysannes et de la lumière, leurs voix baissaient avec le jour, et, leur nombre diminuant aussi peu à peu, les dernières proposaient leurs denrées en chuchotant. On distinguait de sombres silhouettes qui se penchaient pour humer le parfum d’un melon, et les mains sèches des ménagères pauvres palpant les fruits au rabais. Puis, tout disparaissait avec un bruit{44} de sabots sur les pavés, laissant au sol des détritus invisibles, une odeur de vergers saccagés, et je ne sais quel agrément de silence.
Des volets s’ouvraient à une maison située à l’autre bout des Quinconces. On disait:
—Tiens! Mᵐᵉˢ de V... sont rentrées!
Et Mˡˡᵉ Marie de V... s’accoudait au balcon.
Hier, en passant par les allées de l’Observatoire, j’ai vu un jeune homme assis sur un banc à double face, et derrière lui était une femme, un coude posé sur le dossier commun. Un doux air de printemps soufflait et le feuillage tout neuf des marronniers est d’un vert qui donne la fringale. Je les ai regardés, mais c’est moi que je voyais, par une même saison et un même parfum de l’air nouveau, sous les tilleuls d’un beau jardin d’où l’on découvrait la Loire: derrière moi, une amie dont le bras pendait près de mon épaule, me dit en repoussant d’une chiquenaude le bord de mon chapeau de paille:
—Ah mais, mon cher, c’est que vous avez des clairières!...
Et pendant que je tâchais d’en rire, il me semblait tout à coup que ce paysage, cette saison, ce beau bras qui pendait, et encore quelque chose d’élégant et d’exquis, fait du mouvement de jeunes femmes, sous ces tilleuls, s’enfuyaient à mille lieues de moi en me délaissant à jamais.{45}
Et, à distance, le souvenir de cette alarme, qui fut une première peur de vieillir, me fait mal au cœur.
C’est la nostalgie de ma jeunesse que j’ai. Voyons, raisonnons-nous!
Raisonnons-nous? Comme un fat qui ne voit pas son visage! Comme un viveur qui croit que le plaisir s’achète! Comme un philosophe stoïcien! Raisonnons-nous! Mais, en vérité, ma plainte est plus belle. Le loyal aveu de l’amour, et le cri désolé de l’homme qui dit adieu aux grâces de la terre sont un plus noble hommage à l’amour même et à la charmante jeunesse, que l’aigre et muet dépit avec quoi l’on se pétrit le masque qui convient au chemin du retour.
Voici l’endroit où j’ai goûté, dans le plus pur recueillement, l’heure qui passe. C’est au jardin du Luxembourg, sur la terrasse des Reines de France, entre un vase contenant des géraniums grimpants et un arbre d’aubépine, contre la balustrade circulaire d’où l’on a la vue si belle sur le parterre fleuri, sur le grand bassin, sur ces panaches, au loin, de marronniers, à la Watteau, et sur ces magnifiques platanes en lamelles d’or qui augmentent la gloire du soleil couchant, l’été, près des deux tours de Saint-Sulpice.
Tous mes espoirs et toute ma déception, toutes mes chimères, toutes mes douleurs, le peu d’intime bonheur aussi que j’ai eu, c’est là que je suis venu, chaque soir, en répéter, grain à grain comme un{46} rosaire, l’expression ardente et désespérée. Car même mon plus vif plaisir est tourné aussitôt en tristesse. Et j’aime mieux la forme des choses qu’un visage: elle sait me plaire et elle ne me juge point;—surtout elle ne m’a jamais dit: «Tu exagères...».
Oh, comme il faut que je me sache seul pour bien sentir, c’est-à-dire pour sentir si fort que la traduction rigoureuse en paraîtrait insensée!
Les soirs que j’ai vu tomber là, à l’arrière-automne, ne restera-t-il d’eux rien du tout que mon souvenir muet et cet étrange plaisir que j’éprouve en pensant à ces soirs finis, et qui se confond avec une douleur? Mais si demain je ne suis plus, ce souvenir même sera évaporé... Je ne me révolte pas contre la mort possible; mais l’extinction de cette flamme sensible que j’ai toujours vue briller à côté de moi me terrifie comme la perte d’un de ces êtres tels qu’il y en a et qui nous sont plus chers que nous-mêmes.
Le noble ennui, le bel ennui que l’on a quand on est seul!
L’ennui chagrin et laid qui nous vient de la compagnie!
J’aime mes jours passés comme si j’allais perdre le goût de la vie ou de la lumière, et les instants qui ont retenti si beaux dans mon âme depuis que j’ai{47} l’âge de sentir, remontent à mon cœur tout seul et m’étouffent.
O ne plus voir que des visages que le goût de la Beauté a baptisés!... Beethoven, ta tête douloureuse! Flaubert, ta sainte colère! Vigny, la noblesse de ton amertume! O bien-aimé Watteau, ta mélancolie!...
J’aime ces figures d’hommes que l’émotion a ravagées. Un bel artiste, vers la quarantième année, a pris le masque de son art même, et ses yeux sont profonds et pleins de choses dorées et de lumières, comme ces enfilades innombrables de pièces que l’on voit dans la glace d’un salon où une autre glace se mire.
Pendant vingt ans, avec quel soin joyeux et quel émerveillement intime j’ai cueilli l’heure ou le moment fugitif qui passaient en pénétrant ma chair et mon cœur jeunes!—c’était quand ils engendraient en moi un appétit et un espoir indéfini d’amour. Le soleil qui me comble d’une joie d’enfant, le soir qui fait semblant de déposer en moi quelque chose de Dieu, la pluie sur les feuillages, le tournant d’un chemin où je suis soudain enivré sans savoir pourquoi,—tout cela par soi-même n’est probablement rien, tout cela me leurre, me laisse croire que j’ai deviné, comme un bon sourcier, la veine sacrée qui arrose de poésie{48} l’univers, mais tout cela ne fut jamais bon qu’à féconder des désirs d’amour. Quand j’ai verdi tout à coup, à Saint-Cloud, un jour où l’automne, trop beau, tombait avec les feuilles d’or des platanes dans une contre-allée, sur les degrés de la fontaine, c’est parce que je pensais: «Plus beau encore que cela, il y a mon amour.» Quand j’ai pleuré, un soir de mon enfance, tout seul, au fond d’un potager de province, alors qu’une voix de femme, de l’autre côté du mur, criait au loin ces mots quelconques: «Je suis dans l’allée des framboises...», c’est qu’une précoce révélation m’affirmait que j’aimerais un jour.
La sublime vérité qui est au cœur du monde, la beauté, ne doit être sans doute qu’un court instant soupçonnée ou entrevue par la créature: aussi, à mesure que le tremblement du beau nous agite—magnifique et ruineuse tempête—il sème en nous la graine vivace du désir d’embrasser un être qui nous endorme ou nous stupéfie.
En arrivant dans un lieu où je suis appelé à faire un séjour, j’escompte le plaisir que j’aurai, plus tard, lorsqu’il ne me restera de ce lieu que le souvenir. C’est une façon de courir tout de suite au plus beau, à l’exquis, le présent n’étant jamais pur.
Il y a ici une terrasse à balustrade d’où la vue s’étend sur la baie des Anges. Le parasol d’un pin,{49} des pointes de cyprès, des fûts de colonnes à chapiteaux corinthiens, plantés dans les jardins qui descendent vers la mer, forment la base de ce tableau, italien, classique, qui contient Nice, son port, ses montagnes, et la courbe heureuse d’une côte allant mourir au Cap d’Antibes. La colline du Château, son granit écorché du côté de la mer, son dos velu de feuillages obscurs, semble un gros monstre blessé, assoupi entre la ville aux toits roses et le long môle qui retient dans le port une eau savonneuse. Le ciel n’est pas d’un bleu cru, que l’on peint, mais il est doux, pommelé de flocons blancs et mauves, et il se dégrade jusqu’au gris perle très clair, pour toucher les sommets neigeux des montagnes. Tout cuit au soleil. De petites barques, se mouvant à l’aviron, ont d’ici l’aspect d’araignées d’eau sur un étang, il n’y a qu’une seule voile blanche au milieu de ce grand golfe tout nu. Les bruits du port, lointains, mais ramassés, montent par instants, puis s’écartent, au gré du vent, comme la rumeur d’une conque marine appliquée plus ou moins près de l’oreille.
Le soleil est amoureux de cette baie; c’est lui, dirait-on, qui l’a couchée là, et il la tient; depuis plusieurs semaines, il n’en est pas repu; elle est vautrée devant lui, soumise et lascive; elle s’étire; je crois voir là-bas, en ce rivage courbé, couleur de chair, son long bras paresseux, languissant ou pâmé.{50}
J’ai escaladé quelques roches et j’ai trouvé un sentier qui se faufile en montant toujours, sous un bois de pins plein de parfum et de paix. En m’y asseyant, à l’ombre, j’ai regretté de n’avoir pas la simplicité de ceux qui, pour un instant de félicité comme pour un malheur, prennent Dieu à témoin de leur cas particulier et le remercient ou l’insultent par des chants bien rythmés. Qu’il doit être agréable de prolonger et d’élargir son émotion jusqu’à la folie de croire en faire part à l’élément divin du Monde! Quelle liberté, quelle abondance et quelle audace une telle illusion donne à la pensée, à la sensibilité et au langage! Qu’ils vont paraître pauvres, les poètes qui se heurteront sans cesse à la dure paroi de marbre de la vraisemblance et de la justesse d’expression! Par quelle intensité remplacer la frénésie? Et l’amour, par exemple, sans naïveté, comment le peindre?
Les pommes de pin de l’an passé étaient froissées les unes contre les autres par un vent presque imperceptible, et, dans le silence et l’immobilité de toutes choses, j’ai levé la tête en cherchant l’animal qui avait bougé. Délicat moment! presque inappréciable charme!
Je me suis relevé, et, dix pas plus loin, le sentier ayant incliné vers Nice, le grand murmure de la ville m’a atteint tout à coup. C’étaient des milliards de bruits divers ramassés en un chuchotement doux à l’oreille, ils provenaient d’un trou immense, profond et invisible. Mais, en montant sur un roc, j’ai aperçu,{51} entre les aiguilles de pin, un fond rose: la mer des toitures. Retourné en arrière, c’était de nouveau la forêt, le silence. J’ai joué, comme un enfant, à ces alternatives qu’un clair symbole embellissait pour moi; j’enjambais, tantôt en un sens, tantôt en un autre, la frontière qui sépare la solitude méditative et le troublant bavardage de la vie en commun.
Oh, comme je sens que j’aime trop cet endroit, cette tentation et ce refuge, cet appel fascinateur des villes et ce tronc de sapin où je me cramponne!
Voilà le soir qui vient. Le soleil commence à nous envoyer les reflets de sa lumière sur la mer striée. Et cela forme un long triangle de feux électriques à éclats brusques, dont le sommet est à cinq kilomètres, et la base sous les balustres de la terrasse.
A mes pieds, il y a une corbeille de pensées, la pelouse de gazon inclinée, une plate-bande d’œillets épais comme des pivoines, la balustrade portant, à chaque pilastre, un vase de géraniums rouge sombre; puis viennent, en contre-bas, les sommets des cyprès, le parasol d’un pin, et la baie où s’étale une mer de lait bleu. C’est sur la droite que le soleil joue à mille feux, le reste de l’étendue est d’un calme absolument pur, et, au beau milieu, vogue, solitaire, une petite barque de promenade de la valeur, pour nos yeux, d’une coque de noisette, et où je discerne pourtant une ombrelle.{52}
Et je souris à cette image: au centre d’un tableau grandiose, si noble par ses lignes tranquilles, si pur par l’absence de tout mouvement humain, une ombrelle disproportionnée se balance; elle attire et concentre la lumière sur sa claire soie tendue; elle n’est qu’un point; le paysage est immense; elle me force à ne regarder qu’elle. L’éclat multiple du grand triangle lumineux s’atténue, va s’éteindre; l’ombrelle, d’abord incolore, se précise, jaunit, semble absorber toutes les clartés d’alentour. Quelqu’un a traversé le jardin, sans regarder le paysage, mais a dit: «Tiens, une ombrelle...» Je tâche de ne plus voir ce petit coin encombrant; à l’embouchure du Var une admirable fumée élève dans l’air immobile ses houppes perpendiculaires; et les dos nuancés d’une dizaine de chaînettes montagneuses qui se couchent et s’abaissent à lécher là-bas le rivage de la mer, à la pointe d’Antibes, sont plus superbes que ne fut jamais aucune femme... Splendeur, grandeur, sérénité, beauté! une ombrelle se mesure à vous!
⬛
Le génie du christianisme, c’est, notamment, d’avoir découvert qu’un élan du cœur a plus de force que la plus grande pensée.{53}
C’est ce que Pascal appelle «le mouvement de charité».
Le chrétien parvenu au faîte de la pensée humaine, par exemple Pascal, se prosterne et s’humilie. Et loin d’en être diminuée, sa science en reçoit je ne sais quel rehaut.
Mais cela est convenable surtout quand on est parvenu au faîte...
Il y a, dans l’œuvre d’art, quelque chose que tout être bien doué est capable de comprendre d’emblée. Il y a quelque chose que quelques-uns seulement sont aptes à saisir: c’est le métier, le procédé, la technique. A cause de ce petit nombre d’habiles, que l’on confond avec une sélection et en prêtant au mot une vertu qu’il n’a pas, on ne retient plus que le jugement de ces quelques connaisseurs professionnels. Et personne ne remarque que c’est la gent aveugle des érudits,—celle qui jamais ne se baigne dans les eaux vives—qui, peu à peu, gouverne les arts. Le catalogue se fait indispensable à l’admiration, et l’herbier remplace la nature.
L’indifférence à la question morale, dans la vie courante, est la marque d’une certaine insuffisance d’esprit.
Le goût moral dans les arts qui ne l’excluent pas,{54} par exemple dans le roman, mais c’est encore un reste de préoccupation intellectuelle! Et à ce titre il ne le faudrait pas tant mépriser.
Ce n’est pas leur moralité ou leur moralisme que je reproche aux ordinaires romans moraux, c’est qu’ils sont construits artificiellement, c’est qu’ils sont faits pour la morale et non pour la vérité humaine.
Le plus sûr moyen de moraliser, pour un homme de lettres, ce n’est pas de prêcher la morale ou d’imaginer arbitrairement des intrigues aboutissant au triomphe de la vertu; mais c’est de montrer que l’on a de la conscience, et particulièrement celle de son métier. Or, la conscience du romancier, c’est de rendre avec fidélité la vérité humaine, de peindre les mœurs sans détours si l’on traite des mœurs, de ne point fausser des caractères ni travestir ou enrubanner les passions, si c’est cette étude qui fait votre sujet.
Nous devons traiter notre sujet, comme un savant la matière de ses expériences ou de ses observations. C’est une matière dont nous ne sommes pas les maîtres. Il est permis sans doute à notre génie d’en tirer telle lumière qui la présente sous un jour éclatant et nouveau, mais force est à cette lumière de n’éclairer jamais qu’un objet réel. Encore taisons-nous sur ce pouvoir possible d’illumination, ou, s’il se peut, ignorons-le, car c’est en traitant la matière humaine de la façon la plus humble, que nous avons{55} le plus de chance de tirer tout ce qui est à la fois en elle et en nous.
On ne s’élèvera jamais trop contre les conseils pernicieux de telles gens, bien intentionnés, qui voudraient nous faire forcer la nature ou les faits dans le but de présenter du monde une histoire édifiante. Un enfant un peu sagace perce tout seul ces traîtrises, et c’est vous, apôtres,—prenez garde—qui le faites rire de la vertu. Tandis qu’il s’échappe de l’honnête vérité quelque chose d’auguste qui rend plus fort sinon meilleur.
Wilde avait raison de s’élever contre Ruskin qui tend à mesurer la valeur d’une œuvre à la somme d’idées morales qu’elle contient. Car ce n’est pas l’idée morale qui crée l’art.
Mais Wilde se trompe quand, par esprit de réaction contre une telle impertinence, il voudrait que l’œuvre d’art fût à ce point indépendante de la morale qu’elle n’eût même pas de sujet. C’est confondre art et métier. On prend un sujet quelconque, on le traite, et l’on manifeste, par sa manière propre de le traiter, que l’on est original, et artiste. Théorie dangereuse, pente rapide vers la décadence.
L’art est le résultat inattendu de la combinaison de certaines clartés et d’une indéfinissable ingénuité. Il n’est pas que l’aboutissement d’une méthode, la floraison d’une doctrine. Il résulte en définitive de la qualité{56} de l’émotion intense qu’un être éprouve; il est l’expression d’une vibration singulière de la sensibilité. Or, quoi de plus propre que l’idée morale à émouvoir certaines sensibilités? L’idée morale, comme toute idée, peut fort bien engendrer une émotion qui revête le caractère esthétique.
La morale est en partie un ensemble de conventions utilitaires—et à ce titre déjà respectable—mais elle est en outre un commandement, d’ordre mystique: elle est au nombre des grandes puissances. Elle gêne habituellement la vie, mais elle seule la rend possible. Le roman, qui est de tous les arts celui qui presse la vie de la façon la plus complète, la plus profonde et la plus précise, peut-il se déclarer étranger à la morale? Le mépris de la morale, ne serait-ce pas la dernière défroque d’un romantisme à courte vue?
Il ne saurait me venir à l’idée d’accommoder une série de faits de manière à établir ce qu’on appelle une «situation» qui fasse palpiter le lecteur dans l’attente d’un événement ou d’un dénouement. Une seule chose m’intéresse, c’est le trait qui marque un homme, celui qui détermine une société, et celui, plus cher à mon œil, qui laisse soupçonner la proportion entre l’homme et son groupe et ce je ne sais quoi que nous concevons de supérieur à l’homme et aux sociétés.{57}
J’aime les caractères et les mœurs bien définis, où je vois une invitation à réfléchir indéfiniment sur la position de l’homme dans son monde et aussi dans un plus vaste monde. Lorsque j’ai pu les mettre en évidence sous une forme vivante et équilibrée, et en leur laissant, sans le souligner, tout le premier rôle, je tiens ma tâche pour accomplie; au lecteur de comprendre ou bien de jeter là mon livre en déclarant «qu’il ne s’y passe rien».
La Comédie, genre plaisant et non pas gai, et que constitue principalement le choc du réel contre la logique ou l’idéal, elle prend son meilleur aliment dans les sucs de ce terrain à mi-côte, entre les hautes et les basses terres. Elle ne fait point sonner ses titres de noblesse comme le drame ou la tragédie qui sautent de sommets en sommets convenus. Elle chemine à pied, sans tambour ni trompette; elle n’annonce ni ne promet rien; elle a tôt fait de décourager les benêts accoutumés à juger les gens sur la mine. Cependant nous la tenons, nous, pour l’art le plus viril et le plus raffiné. C’est, par excellence, l’art du lettré, parce qu’il n’est goûté que d’un esprit attentif, averti, curieux de l’homme, épris, par-dessus tout, de psychologie, habile à mesurer par lui-même les degrés divers des valeurs et ayant accompli le tour à peu près complet de toutes choses. Art garanti de la préciosité, du factice et de la manière, parce que, sous peine de{58} n’exister point, il prend sa source dans le sol vulgaire et que le talon de l’homme a foulé. Il a du populaire en ses racines et de l’extrême culture en sa floraison. Il a, entre toutes, cette vertu singulière et si peu reconnue, qu’il est le résultat non du désir arbitraire du poète, mais de la lutte de l’imagination créatrice contre la résistance naturelle des choses; l’homme ne s’y guinde pas, au gré du modeleur, selon une pose hiératique qui le grandit d’une manière facile, et n’y adopte pas les attitudes exquises qui gagnent si aisément les suffrages; mais il impose, comme le bois, le marbre ou l’étain, les ingrates exigences de la matière. Les hautes visées, propres aux grands genres présomptueux, non, assurément, la Comédie ne s’en prévaut pas, et peu s’en faudrait qu’elle les reniât, alors même qu’on les découvre en elle, mais il est possible qu’elle en suggère l’idée et en répande la graine, de ce geste simple et tranquille, et si beau, du semeur qui a l’air d’accomplir un acte ordinaire et d’en ignorer les conséquences sans nombre.
Le principe d’autorité ayant été, quoi qu’on puisse dire, ruiné et jeté bas, l’autorité indispensable à la vie ne pourra être restaurée que par des hommes qui, ayant eux-mêmes commencé par renier absolument toute autorité, se sont conduits comme si l’autorité, et tout ce qu’elle comporte de principes nécessaires, était inexistante et inutile, en ont reconnu à l’épreuve{59} le caractère indispensable, et la fondent à nouveau, non pas sur le respect traditionnel des anciens, mais sur leur propre expérience.
Il y aura des Pères de l’Eglise morale. Ce seront, en littérature, des écrivains amoraux assagis et dégoûtés; ce seront des femmes émancipées, qui, ayant par hasard conservé quelque jugement, déclareront: «Nous avons tout essayé: eh bien, non, ça n’est pas possible; il ne faut pas que vous nous imitiez, nous avons fait erreur.»
Il est impossible aujourd’hui de refonder une autorité sur autre chose que sur l’erreur reconnue, sur les désastres de l’expérience individuelle.
Et sur quels désastres!
Le résultat de ces conférences auxquelles pas un homme ne résiste, c’est que la pensée qui eût pu être exprimée avec plus de franchise et de liberté dans l’article ou le livre, c’est-à-dire dans la solitude du cabinet de travail, est obligée, comme l’art dramatique, de se placer de plain-pied avec l’esprit public, et pire: avec un auditoire déterminé dont il faut, bon gré mal gré, flatter les passions ou ménager la médiocrité. Trop de conférenciers, depuis la mort de Brunetière, n’ont pas le courage de heurter au besoin le public, en le subjuguant par la puissance oratoire; ils se mettent à son niveau; pour un peu, ils lui demanderaient pardon de lui apprendre quelque chose.{60} «Nous sommes là, dit Faguet, pour travailler ensemble...» Abomination!
Faguet, dans sa troisième conférence sur La Fontaine, fait bien la distinction entre les fables qui ne contiennent aucune morale et qui sont plus des trois quarts d’entre elles, et les fables qui semblent contenir un conseil, un avis de l’auteur. Et il établit que la majeure partie de l’œuvre du fabuliste constate simplement les faits.
A cause de cela, il prétend que l’on ne devrait pas mettre les fables de La Fontaine entre les mains des enfants.
Et il se fonde sur un exemple, une chose vue. Une petite fille à qui sa mère explique la fable de La Cigale et la Fourmi, entendant que la fourmi fait la récalcitrante et renvoie la cigale «quand la bise fut venue», arrête sa mère et lui dit: «Non, ça n’est pas ça...». «Comment, ça n’est pas ça, mais voilà le texte..... etc.» La petite dit: «Non, la fourmi la gronde mais elle lui donne un peu à manger.» Et M. Faguet donne raison à la petite. Et j’entends d’ici tout l’auditoire applaudir là-dessus M. Faguet.
Eh bien, l’état d’esprit de M. Faguet là-dessus est pitoyable! On tend de nos jours à ramener la littérature à la conception que le public se fait de la littérature. Et pour le public, la littérature c’est la peinture des gens et des choses tels qu’ils devraient être; le{61} public demande à l’écrivain de satisfaire le désir de suavité et de justice qui est, nous assure-t-on, au cœur de l’homme, et il juge grand écrivain celui qui lui représente les hommes vivant à l’état idéal dans une idéale société.
Satisfaire cette inclination, c’est amener la littérature à la pure niaiserie.
⬛
Sur l’hostilité au «sens propre», à la pensée individuelle, j’inclinerais à penser que la littérature, quoi qu’on veuille, sera toujours l’expression du sens propre, et que, à cette condition-là seulement, elle sera vivante et originale. On pourrait conclure qu’il n’y aurait que deux sortes de littératures: celle qui abolit le sens propre dans l’intérêt général, qui est une littérature saine et bien souvent médiocre, et celle qui exprime le sens personnel, qui est la littérature, et qui est dangereuse.
Un événement caractéristique des temps modernes me paraît être la divulgation et la vulgarisation de la vie intellectuelle. C’est le fait le plus détestable qui se soit jamais accompli sur la planète. Le temple{62} ouvert à tous; plus même de chœur réservé; le mystère dévoilé; le Zaïmph vendu aux femmes pour qu’elles s’y taillent des écharpes. Toute l’humanité en souffre; le déséquilibre général a en ceci sa cause. On a invité les Goncourt au dîner Magny, et ces perroquets aux belles couleurs rapportent les paroles de Renan! Il y a des vérités que l’intelligence humaine ne peut pas s’interdire de concevoir et d’exprimer; mais, ces vérités, incompréhensibles aux petits, ne peuvent être par eux que travesties; et quand elles courent les rues elles sont plus dégoûtantes que les mensonges imaginés par les foules et inventés peut-être pour leur plus grand bien. La plupart des idées fausses sont des idées utiles, nécessaires. Les idées justes, les vraies, n’ont ce caractère que dans le milieu restreint de ceux qui s’égalent à elles. Il faudrait une langue des dieux, insaisissable au commun.
Il n’y a plus aujourd’hui qu’une langue; l’acharnement universel est de faire pénétrer aussitôt que possible dans le public ce qu’un homme supérieur a conçu, a conçu par le besoin naturel à lui de concevoir, non dans le but de fournir un aliment à ces foules qui ne réclament que leur bien. Lui, c’est peut-être—provisoirement au moins—le mal qu’il engendre, et il ne peut s’en soucier.
En art, cette barrière, entre ce qu’il est légitime de penser et ce qu’il est nuisible de répandre, se présente{63} comme un obstacle au développement intellectuel et comme un malentendu perpétuel entre auteur et public.
Celui qui domine la sottise humaine est modéré dans ses propos. L’insurgé, le réfractaire, qui vomit l’invective à l’occasion de toute iniquité, est encore un candide, un jeune ébaubi que choque la lumière du jour.
Une vérité un peu dure, peut-être paradoxale, mais tout de même une vérité, c’est que l’artiste ne va pas sans un certain dédain pour cette chose sacro-sainte aux demi-artistes et aux dilettantes, et qui est l’Art même, ou, si vous voulez, à la rigueur, les formes d’art à lui préexistantes.
L’artiste est celui qui crée; il apporte du nouveau; son fruit n’est conçu que dans une certaine insouciance heureuse, une exubérance de vie qui se moque de tout, hormis de soi et de son plaisir. Tantôt, il apprécie supérieurement les manifestations de l’art qui l’ont précédé, comme il apprécie supérieurement toute chose; tantôt, il leur est dérisoirement fermé.
Le demi-artiste et le dilettante vit du culte de l’œuvre d’art à lui préexistante. Toutes ses facultés artistiques sont captées par son goût d’admirer et par une insatiable curiosité d’objets nouveaux d’admiration. Il{64} s’absorbe en son agenouillement. Il ne peut tenter de produire lui-même qu’à l’instar des œuvres qui le dominent; il est un initiateur né impuissant à trouver la forme nouvelle; dès lors il s’exténue en mille ingéniosités touchant les détails de forme. Érudit, amoureux d’art, bien plus informé que l’artiste ingénument inventeur, il a l’air d’un artiste, tandis que l’artiste véritable fait figure d’ingénu.
En jugeant toutes choses par rapport à des œuvres d’art connues, ou connues de lui, l’esthète, le demi-artiste, ou le dilettante ne fait, en somme, que rejoindre la mentalité de ce bourgeois qu’il méprise. La mentalité du bourgeois touchant les arts, elle est faite de formules d’art souvent périmées, vieillies, usées, mais de formules d’art ayant régné; car le bourgeois, ou le public, ou l’homme normal si vous voulez, en fait d’opinion artistique n’invente rien, ne sent rien: il a une éducation, il a entendu dire, on lui a appris, il a des autorités; jusqu’à sa sensibilité a été façonnée par l’opinion à la mode en un certain temps.
La paix des familles et peut-être la paix des nations dépend du progrès de la psychologie. C’est faute de connaître l’homme,—et mieux: les hommes—, que l’on s’entend mal et se persécute. La plupart des hommes sont incapables de concevoir qu’il existe une autre mentalité que la leur; ils agissent avec tout le monde comme avec leurs semblables. Le malheur{65} est que nous n’avons pas de semblables, et que le quiproquo est continuel.
Le «connais-toi» antique est insuffisant. Le «aimez-vous les uns les autres» est insuffisant. C’est à un «connaissez-vous les uns les autres» que l’avenir devrait s’appliquer.
Il n’y a peut-être qu’une chose certaine, c’est que tout se meut. Nous ne percevons qu’une course universelle, et, qui pis est, à quoi nous prenons part. Or, l’art consiste essentiellement à fixer, et comme pour une éternité d’immobilité. Le rôle de l’art est paradoxal; il cherche le contour immuable des choses qui changent sans répit.
Antagonisme de l’art et de la vie.
Par contre, on dirait qu’il y a un principe commun entre l’art et les sociétés humaines, et ce serait l’économie. L’art, comme l’a dit Mithouard, «est une sublime économie». L’art choisit et groupe avec parcimonie, parce que tout élément inutile est nuisible, et parce qu’il s’agit de frapper comme à la cible, en un point, de tout notre plomb, qui fait balle. Dans la conduite de la vie et dans l’administration des sociétés, on trouverait la même nécessité d’épargner et de ramasser ses richesses et ses forces. Où il y a prodigalité, il y a art défectueux; où il y a prodigalité, il y{66} a misère. J’explique par une secrète intelligence de la règle artistique mon aversion personnelle pour la bohème.
Oh, surtout, surtout, ne jamais faire le malin, l’homme fort, ni si d’aventure l’occasion s’en présentait—l’homme d’esprit! Si vous pensez quelque chose, dites-le donc avec l’humble courage d’un mortel qui sait qu’il peut fort bien penser faux. Nos plus grands, nos plus chers amis, La Bruyère, La Rochefoucauld, veulent dire trop bien. Ils tiennent à étonner, à secouer, ou tout au moins, à faire sourire. Mon Dieu, que ce XVIIᵉ a aimé à plaire! Ils n’ont pas une opinion sans lui faire un sort. Après eux, Vauvenargues est bien plus simple. Il n’est pas toujours moins profond. A côté d’eux, ou au-dessus, Pascal ne cherche pas l’effet, même quand il foudroie. Et Montaigne qui les porte tous, bavarde pour son plaisir, si gentiment.
Ce qu’il y a de plus beau en nous, ce n’est pas l’épanchement, c’est la possession de soi. L’un est un signe de l’abondance, de la richesse, c’est possible; mais l’autre est la preuve de la force. On ne s’abandonne pas parce qu’on est comblé de dons, mais parce qu’on manque de frein. Le frein, dans l’homme, est la première qualité virile.{67}
On ne travaille pas peu.
Les écrivains, par exemple, travaillent beaucoup ou travaillent mal. Ceux qui travaillent peu,—quoi qu’on en dise,—ne sont guère à leur ouvrage; ils n’y entrent pas. Pour y entrer tout entier, il faut du temps; il faut tout le temps. Et le nombre et même la multiplicité des travaux n’y nuisent pas, car il est plus facile d’entrer dans son travail au sortir d’un travail différent qu’au sortir de l’oisiveté. On ne travaille pas peu, on travaille beaucoup, ou bien on travaille mal ou point.
Je déteste les esprits anarchiques; et les esprits purement conservateurs ne me plaisent qu’à moitié. Les seuls esprits que j’aime, sont ceux où je découvre un sens anarchique spontané mais perpétuellement en lutte et finalement dompté par le sens organisateur.
C’est ce dualisme qui crée.
L’homme en possession de la gloire croit volontiers qu’il la doit à un don du ciel; mais la femme se plaît à reconnaître comment elle a su organiser sa renommée. Le goût de la gloire artistique chez la femme coïncide avec un affaissement de la conception de la gloire. Celle-ci n’est plus divine; elle s’obtient par intrigues; elle est à la portée des manœuvres. Les femmes détruisent la gloire dès l’instant qu’elles la font.{68}
La femme a l’esprit enclin à la chimère parce qu’à l’ordinaire elle manque d’imagination. On ne veut pas admettre que la véritable imagination est celle qui conçoit le «réel» et non pas «l’absurde». Rien de plus aisé que d’imaginer l’impossible; nul contrôle, nul frein ne s’impose à l’esprit débridé: il chevauche par-dessus les gouffres et les océans, impunément; mais imaginer le réel qui n’est pas encore, voilà la tâche virile, et difficile. Le réel ne flatte pas, et il est serré dans la gaine étroite des innombrables impossibilités.
On ne voit presque jamais un esprit s’appliquer à un objet pour le juger. A l’occasion d’un objet, un esprit, même distingué, se met en branle, et le voilà qui part et bondit, tirant tout de soi, ne laissant quasiment rien à ce qu’il a entrepris de juger. Le propre de la critique serait précisément de faire le contraire.
L’expression de plus en plus générale ennoblit le discours aux yeux du lecteur. Mais l’évolution de la littérature, depuis deux ou trois siècles au moins, a consisté à faire passer l’expression du plus général au plus particulier. Et il est évident que c’est à caractériser le plus singulièrement possible qu’il y a le plus de difficulté. Secouer la dure obligation de préciser, et gagner les régions nébuleuses, satisfait l’âme idéaliste,{69} mais déçoit et exaspère un esprit analytique, et même un esprit d’enfant.
Si Chateaubriand, voulant signifier qu’il se trouvait à Londres, dit: «Quand j’étais au delà des mers», il m’est insupportable, malgré l’euphonie de sa phrase. Et s’il veut dire qu’il était pauvre, et écrit: «Alors que je n’avais pour table à écrire que la pierre de mon tombeau», il me fait rire.
Nous sommes toujours préoccupés de perdre notre jeunesse. Mais le bien le plus précieux que nous ayons possédé, c’est l’enfance: et elle est toujours perdue. L’enfant est bien supérieur au jeune homme; et malgré l’appareil de nivellement dont l’éducation le fait souffrir, il a plus de bonheur que l’on en a à un autre âge, parce que son activité spirituelle est plus grande et parce qu’il peut imaginer. Et puis, quoique enchaîné, il est libre, il est la seule créature libre.
La jeunesse? Mais elle est déjà possédée par l’instinct grégaire, elle n’aspire qu’à suivre les bergers, bons ou mauvais. L’enfant, lui, jouit de cette courte période de la vie humaine durant laquelle chacun peut impunément créer le monde à sa guise. D’un tabouret de cuisine, il fait un trône, un lac, le continent africain ou une plate-forme pour «berthas»; et ces valeurs, entre enfants, ont cours comme les billets de la Banque de France. L’enfant est roi et il est{70} dieu. Je m’incline devant sa majesté, et j’ai pitié des grandes personnes qui, toutes, pleurent leur jeunesse assez généralement niaise, et non les quelques années où elles eurent du génie.
Le sceptique, c’est l’homme attaché au système traditionnel. Il juge que le monde est incapable de trouver par lui-même son chemin, et que le mieux est de s’en rapporter à ceux qui l’ont déjà parcouru.
L’esprit fort, ennemi de toute tradition, est au contraire homme de foi: il a une confiance éperdue en des lumières qui n’ont pas encore fourni la preuve de leur efficacité.
Le goût passionné de la bonté peut parfaitement cohabiter chez certaines personnes avec une inconsciente cruauté. C’est qu’un être bon a besoin d’accomplir des actes de bonté; il n’en a jamais accompli assez; et pour exécuter un acte nouveau de bonté envers une personne, il en lésera dix autres avec la plus déconcertante désinvolture.
Le goût de la bonté est rarement éclairé; c’est un instinct, un besoin; il tend à s’exercer, simplement. Lorsqu’il a fixé son bénéficiaire, il se rapproche du sentiment de l’amour: il est exclusif comme lui, et redoutable.{71}
Il n’y a rien de pire que ce qui s’approche du génie sans l’égaler. Le faux sentier, voisin du vrai, qui se dirige aussi, lui, vers le sommet sans y conduire: il faut le quitter à un moment donné, et pour le précipice.
La marche en montagne est peu faite pour l’homme. Si vous n’avez ni flair ni guide, restez donc dans la belle vallée.
Mais l’alpinisme spirituel est devenu à la mode comme l’autre. Ils ont un costume spécial, un piolet, un certain air pour escalader les cimes de la pensée. Tous s’enorgueillissent de vous dire qu’ils ont touché là-haut le néant, la nuit noire. Je souris en contemplant les bords ensoleillés de la mer.
Une femme veuve, d’un certain âge, me dit que ce qu’elle regrette le plus en son mari, c’est le compagnon, le seul être devant qui elle pouvait exprimer tout chauds ses sentiments, ses impressions ou ses idées contradictoires. Il n’y a point d’amis, me dit-elle, devant qui nous puissions faire cela, parce que devant même les plus intimes nous voulons conserver une certaine tenue de jugement, crainte de passer pour hurluberlus; mais le mari, c’est l’homme devant qui l’on ne se surveille pas, celui qui peut, sans dommage pour nous, hausser les épaules à ce que nous disons. Nos jugements un peu sérieux, nous ne les prononçons pas tout de suite; auparavant nous tâtonnons; nous nous essayons; nous griffonnons un{72} brouillon; c’est cette page hâtive, incomplète, violente, injuste, ridicule, mais notre indispensable premier jet, qu’il s’agit de produire devant quelqu’un, non pour demander un avis, mais pour nous donner forme à nous-mêmes, ce que nous ne ferions pas devant un meuble.
Les œuvres vivantes et dépourvues d’enseignement direct, on leur reproche à tort de ne pas conclure. On conclut toujours. Le moindre fait divers suggère une conclusion morale. Mais elles sont le fait d’auteurs courtois qui vous font l’honneur de croire que vous êtes de taille à comprendre le sens des images.
Les conditions de la pensée humaine sont telles que celle-ci vient fatalement s’inscrire en des cadres schématiques imposés par l’hérédité ou par les influences du jeune âge, et au delà desquels chaque individu ou groupe d’individus ne conçoit qu’aberrations ou bien ne conçoit rien. Nous pensons tout selon un mode convenu et si sérieusement accepté, que nous ne doutons pas qu’il ne s’adapte exactement à la réalité des choses. S’il est trop évident qu’il ne s’y adapte pas, alors nous doutons des choses plutôt que de la valeur de notre encadrement.
Et le pessimisme de celui qui réfléchit, vient de l’obligation où il se trouve de comprendre que la vie{73} des hommes n’est possible que rangée artificiellement à l’intérieur de ces figures. Ouvrez la barrière, c’est la débandade et la perte presque totale du troupeau.
Ce que l’on nomme originalité et même génie n’est que le pouvoir de certains êtres de penser sans le secours de ces pochoirs. Un hasard singulier les en affranchit. D’où vient qu’ils étonnent, stupéfient, scandalisent. Ils ont brisé les cadres sacrés et ils ont l’air de vivre quand même.
Et, en effet, ils vivent. Il va sans dire qu’ils ne le font qu’à la condition de forger eux-mêmes, consciemment ou non, des cadres différents, inacceptables d’abord, qu’un petit groupe adopte et puis impose, et qui obligent de nouveau, pendant un certain temps, les hommes.
De sorte que, de siècle en siècle, si ce n’est de décade en décade, le visage de l’homme apparaît, toujours à peu près identique, mais dans des cadres différents qui modifient son aspect et le rendent même quelquefois méconnaissable.
Ce n’est pas tant leur maîtresse que les hommes aiment, c’est l’esclavage où ils sont tenus par elle; et ce n’est pas tant l’esclavage que le service régulier, que l’obligation quotidienne, à heure fixe.
On observe chez le chien cette inclination particulière à accomplir les mêmes fonctions aux mêmes heures; on l’observe chez presque tous les animaux{74} et chez les gens surtout qui ont l’esprit borné; on l’observe dans les organes physiologiques. C’est une sorte de loi de nature. Si l’on en fait une vertu, sous les noms de ponctualité, de fidélité, quel euphémisme! Ce n’est que le geste de nos organes endormis.
Un homme aime par-dessus tout à se rendre à une certaine heure à un endroit déterminé. Le véritable repos de la journée aura lieu à l’instant où il ne se demandera pas ce qu’il doit faire, où ce qu’il doit faire échappera à la pénible opération du choix. L’amour est très rare; mais ce qui est commun, c’est le rendez-vous de cinq heures. Et peu importe, en somme, que l’on prenne au rendez-vous grand plaisir: la nature, comme la société, a peu souci de la vérité et de ses nuances; elle nous offre le plaisir dans la seule formalité.
Peut-être que tout est à reviser. La sagesse même de La Bruyère est mise en défaut par la transformation de toutes choses en notre temps extraordinaire. La guerre, par exemple, pouvait-elle, au XVIIᵉ siècle, inspirer le respect que nous éprouvons pour son horreur même? Non. Parce que, limitée et parfois caprice de prince, elle pouvait offrir quelque prise au ridicule, tandis qu’elle est devenue auguste en se faisant gigantesque, en cessant d’être une entreprise privée pour devenir un mouvement de peuples ou de{75} continents, en devenant tout au moins la servitude d’inconscients sans nombre.
La critique même de sujets si grands doit s’élever à de telles altitudes que la raison y est menacée. L’analyse s’envole d’un coup d’aile au lyrisme.
La recette du Succès a été donnée par Voltaire. C’est, je crois, dans une lettre où il dit que la fortune de Dante est remarquable parce que l’œuvre de ce poète n’est à peu près lisible par personne, mais que deux ou trois vers de lui sont dans toutes les mémoires.
Si vous voulez atteindre le Succès—j’entends le Succès de bon aloi—il convient d’édifier patiemment une œuvre inextricable ou obscure, mais parsemée de quelques pensées ou au besoin de mots qui puissent paraître suggérer des dessous profonds. On ne retiendra que ceux-ci, mais ils passeront de bouche en bouche; on dira que le reste est douteux, mais le reste sera interprété à la faveur des trois pensées ou des trois mots; et précisément parce qu’on ne les comprend pas, il se trouvera quelqu’un pour affirmer qu’il est sublime, et le mot de génie—que l’on refuse ordinairement à l’auteur d’une langue claire—sera prononcé.
Vous aurez des thuriféraires et des élèves; on commentera éperdument votre néant; on trouvera mille sens divers où vous n’en avez pas mis un.{76}
Si vous aviez commis l’imprudence d’avoir une pensée nette, elle ne compterait jamais que pour une.
Parlez beaucoup de l’âme, et vous la créez ou la révélez. A force de dire qu’elle n’existe pas, vous l’étouffez en son germe: elle allait peut-être naître; qui sait?
Je me heurte le front contre les limites des êtres. On s’y fait des bosses. Tout à coup un esprit vous apparaît derrière le mur qu’il ne peut pas franchir. C’est faute d’avoir bien regardé tout d’abord. Nous pourrions nous épargner ces chocs.
A quelqu’un qui me dit: «Mais vous n’êtes plus le même avec moi, je vois bien qu’il y a quelque chose de changé...» j’ai envie de répondre: «Le mur m’a fait mal... j’allais, j’allais de l’avant, je croyais pouvoir aller toujours...»
Toutes les sciences ont leur chimère après laquelle elles courent sans la pouvoir attraper. Mais elles attrapent en chemin d’autres connaissances utiles... La morale aussi a sa chimère. C’est le désintéressement. On n’y parviendra jamais; mais il est bon que l’on prétende y parvenir. Il faut en toutes choses que les hommes se proposent un point de perfection au{77} delà même de leur portée. Ils ne se mettraient jamais en chemin s’ils croyaient n’arriver qu’où ils arriveront effectivement: il faut qu’ils aient à contempler un terme imaginaire et prestigieux.
Les critiques aiment beaucoup à dire qu’il n’y a jamais création. Là, on les sent sincères.
Il est à remarquer que l’Amitié fléchit un peu dans les sociétés où l’amour règne en maître. Dans les sociétés issues du christianisme, sinon chrétiennes, c’est-à-dire où la femme conserve son rôle de mère et de gardienne austère du foyer, les hommes cherchent un secours entre eux et y trouvent la précieuse, l’incomparable amitié. Dans les sociétés comme la nôtre où les amours sont faciles et où l’on vit sans cesse avec les femmes, où les femmes s’occupent de tout, ont toutes les prétentions et surtout celle de l’intelligence, l’homme, dupe des apparences, cherche l’amitié auprès d’elles, et l’y mélange à l’amour, ce qui fait un insoutenable compromis.
L’extrême sociabilité, telle qu’on la voit, par exemple, en France, n’est souvent que le résultat de l’impossibilité où sont les citoyens de se pouvoir entendre entre eux. Quand on ne peut faire parlote{78} intime en un petit coin, on organise de grandes réceptions. Les ménages qui souffrent trop de dîner en vis-à-vis, ont tous les jours des convives. Plus on est nombreux, plus il est aisé de ne pas être du même avis. Il se crée alors une conversation et des relations qui sont de convention et de politesse, d’où tout sujet privé ou profond est exclu, où chacun s’accoutume à parler une langue commune, mais qui n’est jamais sienne ni très importante, et à quoi—ce qui est merveilleux—on finit par trouver du plaisir. Il en résulte la formation d’une opinion et même d’opinions qui sont officiellement celles de ce peuple, et qui cependant ne sont celles d’aucun des individus qui le composent.
Lorsque l’on fait à quelqu’un un succès, il est tel que nous sommes obligés de croire que ce n’est point l’œuvre qu’on loue, ni même l’homme, mais que le public et ses guides sont atteints d’une sorte de besoin physique d’admirer, de sorte qu’ils admireraient tout aussi bien autre chose si autre chose s’était présenté au moment où leur boulimie atteignait l’état aigu.
Les opinions favorables que l’on émet sur une œuvre à succès égalent en ineptie et en injustice les opprobres dont on l’eût aussi bien chargée. Les gens les plus inintelligents deviennent inventifs. C’est dire que, sitôt qu’il y a succès, tout jugement est suspendu et que la passion s’en donne à cœur joie.{79}
Les hommes de nos jours sont tellement accoutumés à rencontrer la fiction vide de toute espèce de sens, qu’il suffit qu’une pensée, même séduisante, soit enveloppée d’images pour qu’elle passe inaperçue.
On pouvait jadis exprimer ses idées, ses remarques, ses conceptions morales au moyen de fables et de romans. Nul ne lit un roman aujourd’hui avec l’idée que c’est là précisément la forme la plus naturelle que l’homme ait trouvée pour exprimer sa pensée.
Tout le monde parle de ses impressions, de ses sensations; personne n’en a. On n’a que des opinions.
Si je dis: «J’aime mieux l’art que la nature» cela fait bondir un auditoire ordinaire; mais pourtant cela signifie tout simplement que je préfère le fruit de l’homme, le fruit de l’esprit humain, le fruit du génie, au fruit du pommier.
Lamartine a fait inscrire sur son tombeau cette devise: Speravit anima mea. C’est tout lui; mais c’est aussi le plus grand, le plus bel enseignement humain; c’est le secret de la vie, qui ne se tient que par l’espérance. Mais, dans le langage lamartinien, cela signifie quelque chose de plus qu’une espérance,{80} cela signifie ce génie ailé et divin qui l’anima toujours, qui n’anima dans son siècle presque personne à l’égal de lui. Dans ce Speravit passe un ange dont on entend le bruit de l’aile. Cela n’est pas la croyance dogmatique, mais c’est l’affirmation du divin, de l’avenir de la terre, de la durée, sans quoi toute vie n’a que faire d’être vécue; c’est encore la projection de soi en avant de soi-même, et en montant; c’est le geste instinctif du génie visionnaire; c’est l’affirmation de l’esprit, de sa suprématie.
⬛
L’écrivain doit-il être le porte-parole de la Société ou doit-il être lui-même, seulement lui-même et en dépit de tout?
Si son œuvre n’est que l’expression de la Société, il se borne au rôle de peintre fidèle ou d’historien. Ce serait encore un beau et grand rôle. Mais, conscient de ce rôle en quelque sorte modeste et subordonné à l’objet, il s’expose à le jouer de façon à contenter de plus en plus la Société, qui, par définition, le dépasse et lui en impose; il risque de la rendre de plus en plus selon qu’il plaît à celle-ci d’être vue. Il devient un peintre de portraits qui exécute l’effigie d’une dame avide d’apparaître en beauté.{81} L’écrivain se renonce en faveur de la Société; il n’est plus qu’au service d’une maîtresse; il ne vaut que ce qu’elle vaut; il perd sa vision personnelle; il n’ajoute rien à la somme des connaissances ou des beautés du monde. Quel que puisse être son talent, le peut-on dire un écrivain de premier ordre?
Un écrivain de premier ordre est celui qui, doué d’une personnalité forte, propose ou impose au monde sa vision ou ses conceptions. Il propose au monde de voir les choses comme il les aperçoit lui-même. Il rencontre, il doit rencontrer une opposition, car la nature humaine est rebelle aux changements et adore les redites; mais la ténacité du maître impose, et bientôt se pique de voir comme lui, chacun affirme avoir été par lui révélé à soi-même.
Le monde, en fait, est gouverné par des individualités peu nombreuses; le monde n’a ni opinion ni vision, il n’est apte qu’à être mené.
L’écrivain doit donc respecter avant tout sa personnalité. Il n’est pas un homme comme les autres; il déchoit en se plaçant à la portée de tous, en se mettant au niveau commun. Il ne doit pas attendre le mot d’ordre, c’est lui qui doit le donner.
J’ai une aversion insurmontable pour les gens dits «d’un certain âge» dès qu’ils sont «cristallisés». Leur jugement est assis, une fois pour toutes; ils ne croient pas pouvoir se tromper; ils{82} n’examinent plus. Ils me donnent le frisson que j’éprouve infailliblement en voyant les juges à l’issue de l’audience se retirer souriants et le teint rose, après «la chose jugée»...
Tout évolue, tout se renouvelle; le monde est une surprise continue; il se peut que l’heure qui vient, m’apporte une lumière que je ne soupçonnais pas; comment affirmer qu’il ne se produira rien de nouveau?
C’est une sérénité que la nature, indifférente au vrai comme au juste, produit, sans doute afin de prolonger la vie; mais parmi la vie qui se meut et se fait à chaque instant, comme une chair, ces gens-là sont comme une masse cancéreuse, immobile et qui engendre la mort autour d’elle.
Tous ces jeunes de vingt ans à peine, et qui me disent avoir absolument besoin d’étreindre quelque chose de fixe et de s’arrêter à un dogme, ne sont-ce pas des cristallisés précoces qui, à peine entrés dans la carrière, déclarent: nous nous arrêtons!
On n’admet rien qui soit nouveau. Quel pesant rabâchage doivent être ces vies dépourvues d’imagination et de curiosité, béates dans l’inertie, affadies par l’ingestion constante des mêmes mets, et où le monde apparaît comme des chevaux de bois toujours présentant les mêmes figures et toujours faisant entendre la même rengaine aux passants stupides.{83}
On s’étonnait de la tristesse d’un très riche amateur et collectionneur d’œuvres d’art.
Je me demande si le goût, la connaissance éclairée et la possession des objets d’art peut causer à celui qui ne les crée point une véritable et durable joie. Il n’y a pas de véritable ni de durable joie hors de notre activité. On m’entend, j’espère. Les choses extérieures donnent de superbes et de vifs plaisirs; j’admets qu’on aille jusqu’à ne pas se lasser de la contemplation d’une belle chose; mais la véritable joie ne peut provenir que de nous-mêmes; elle est un jaillissement qui s’épand sur les choses, mais qui ne saurait provenir uniquement d’elle; elle n’est que dans la création. Aimer même, c’est moins subir le charme d’un être que le créer. L’amour est tout imagination, illusion. L’œuvre d’art n’est pas la beauté aux pieds de qui nous sommes à genoux, mais le poème que nous composons à l’occasion de telle forme. Il n’y a de plaisir profond, à la lecture, que celui qui consiste à collaborer; le livre qui ne provoque point de notre part quelque effort créateur nous laisse froid. C’est pourquoi tant de gens s’ennuient. L’ennui est signe d’impuissance. De là aussi les erreurs singulières de jugement chez les hommes qui semblent les plus aptes à juger: en jugeant, ils créent; en créant, ils s’enthousiasment, ils atteignent au plaisir souverain; mais ils s’évadent hors de l’objet qui leur est soumis. Ils jugent plus loin, plus haut, ailleurs. Ils se trompent par excès de facultés{84} créatrices. Et, hélas! le jugement de ceux qui ne sont pas capables d’imaginer ou de créer à propos d’une œuvre, est toujours insuffisant! C’est ainsi que nous rejoindrons, au moins au figuré, François d’Assise: la véritable joie est dans le dénuement absolu. Nous sommes poussés alors violemment à tirer tout notre contentement de nous-mêmes.
Je racontais à Mᵐᵉ X..., qui est éblouie par le grand monde, ma visite à Faguet et combien j’ai été ému en trouvant sur le palier d’un cinquième étage, dans un escalier sans tapis, cet homme vêtu, comme un pouilleux qui sort de l’hôpital, d’un pardessus usé, coiffé d’un misérable chapeau mou, sorte de calotte ou de chapel tel qu’on en imagine à un écolier du temps du Collège de Beauvais; et tout cet homme fondu, déprimé, abîmé par la maladie, tout ce visage jadis replet, puis bouffi, aujourd’hui réduit comme un pruneau bouilli, où errent de rares poils gris désordonnés et lamentables, et où ne demeurent que des yeux bleus, clairs et phosphorescents: un spectre, une survivance, un cerveau qui dure dans une chair détruite. Cet homme qui, toute sa vie, n’a fait que travailler, que travailler dans un taudis où il n’y a même pas une cuisine, descendait à six heures avec un petit chien pour faire quelques pas dans la triste rue Monge, ou pour aller dîner dans une gargote, avec des étudiants ou des cochers. «Cela m’émeut, disais-je,{85} comme les décors somptueux, les larbins, les hôtels des duchesses vous troublent, vous éblouissent, vous. On me croit aristocrate, et je ne suis sensible qu’au spectre de l’homme intelligent et dépouillé.»—«Poète, me dit-elle, Faguet est plus riche que vous!»—«C’est possible! et peut-être a-t-il le goût de la sordidité. Mais, snobisme pour snobisme, c’est la vue de cet état de dénuement qui déclenche en moi la sympathie ou l’émotion, tandis que l’opulence, quand elle n’est pas traduite à mes yeux par un goût extrême ou quand elle ne s’accompagne pas de l’idée d’une supériorité morale, ne me donne qu’envie de rire ou de hausser les épaules.»
En lui disant: «J’ai en vous une confiance absolue...» pourquoi ai-je détourné soudain les yeux, gêné, et ai-je pensé que certainement il me trahissait?
L’homme vrai, celui qui se cache et sous l’attitude mondaine et sous l’œuvre de l’écrivain, on le découvre pourvu que l’on vienne à être témoin de sa distraction préférée; il est trahi par le moment où on le voit tout à fait heureux.
On a beau faire, toujours et partout la question morale intervient.{86}
Il y a de tout temps des artistes; mais ils ne sont pas forcément où on les croit. Il ne suffit pas de se dire artiste, de s’enrôler dans la bande dite des artistes, d’en adopter le costume, le langage ni même l’état d’esprit, pour être artiste. Le monde des artistes regorge de faux artistes, les faux artistes ne sont que dans le monde artiste; en revanche, il y a des artistes parmi le monde le plus bourgeois, comme il y a des intellectuels, voire même les plus intelligents des hommes, hors du monde où l’on fait profession d’être intelligent. Les barrières sont tout à fait conventionnelles; elles constituent un classement artificiel à l’usage du commun incapable de discerner les valeurs et qui copie consciencieusement les étiquettes, comme un bon provincial prend des notes en parcourant les boxes à l’Exposition.
L’aphorisme des Goncourt: «En littérature on ne fait rien que ce qu’on a vu ou souffert» est une des opinions les plus erronées qui soient. Les Goncourt, comme les hommes de leur temps, croient que l’homme de lettres n’est qu’un témoin vigilant, zélé, doué de mémoire et d’expression. Ils méconnaissent totalement le rôle de l’imagination en art. Et ce rôle est si considérable qu’on n’est pas loin de la vérité en affirmant qu’il est tout. Il y a l’information de l’imagination comme il y a l’émotion de l’imagination. La première n’est que la servante qui va aux provisions.{87} La grande dame, c’est l’autre. Quand l’imagination est nourrie et commence à s’animer, l’art commence.
Je souris quand on m’appelle «romancier d’observation». Je ne suis pas observateur. Je n’observe jamais rien. Je suis ému. Et de cette émotion, joyeuse ou douloureuse, naît en moi l’incoercible besoin de m’exprimer, la plupart du temps, sous forme de fiction. La fiction, quoi qu’on en pense, parle plus franchement que le rapport historique des faits: elle ramasse la multitude des faits et vous les verse de haut en pluie bienfaisante.
Mon émotion, c’est la réalité convertie en poésie: petit miracle ni très commun, ni tout à fait rare; mais les causes de mon émotion, si l’on y prend garde, quelles chétives choses, quelles misères, quels infiniment petits!
Artistes, nous sommes peut-être toujours un peu méprisants, parce que nous sentons la sécheresse de ce que l’émotion ne féconde point.
Il s’agit d’une émotion de beauté.
Nous avons abandonné la morale absolue qui avait formé chez l’homme une conscience, une sorte d’habitude de descendre au fond de soi et d’y trouver le soutien fondamental de notre personnalité. Ce n’était pas seulement l’œil de Dieu; cet œil de Dieu projetait{88} une puissante lumière sur nos facultés, sur nos ressources, sur nos instincts d’opposition comme sur les tendances que nous avions à nous conformer à cet idéal. Par cet examen et par cette lumière nous nous connaissions, et nous étions initiés aux plaisirs mystiques de nous réaliser envers et contre tous, de nous réaliser même contre nous-mêmes, car il se peut que nos intérêts immédiats ou lointains aient à souffrir de cet acte voluptueux et ineffable qui consiste à faire ce qu’on croit supérieur à tout, même à soi. Exaltation du moi par le sacrifice du moi.
Ceci est remplacé par quoi? Par une morale d’homme d’affaires: chacun se demande après un examen attentif de la Société où il est appelé à vivre: «Qu’est-ce qu’un homme dans ma situation peut faire sans se déconsidérer ou se nuire en quelque manière? Jusqu’où un homme peut-il aller sans risque grave? Qu’est-ce qui est admis dans la Société où je vis? et qu’est-ce qui ne l’est pas? Tout ce qui est admis je peux le faire. Un tel a fait ceci; il a tenu tête et il réussit; donc ceci est possible.» Morale opportuniste; tâtonnement d’insecte; morale du chien qui en prend jusqu’au fouet, exclusivement. Dégradation, ravalement de l’homme. Mais, par-dessus tout, perte certaine de la personnalité dans un laps de temps relativement court: l’homme nouveau n’agissant qu’en fonction de la Société, tendant à se niveler en masse selon un modèle d’usage commun, courant et commode, il est désormais incapable des héroïques{89} résistances à l’opinion universelle, des audaces isolées, imprudentes ou dangereuses où l’on s’élançait en vertu d’un commandement intérieur et pour un plaisir de caractère sacré, dont le nom n’a plus de place dans la langue des hommes. C’était le plaisir incomparable, non du héros qui espère réussir, mais de celui qui, d’avance, sait qu’il sera brisé.
Ils ont tous à la bouche cette expression: «Je ne veux pas être un vaincu.»—N’être pas un vaincu, c’est réussir selon l’opinion commune. Mais être un vainqueur pour nous, c’est souvent être terrassé par les barbares, pour un principe ou une idée que notre perte individuelle doit servir.
Ni la gloire ni la popularité ne se maintiennent chez un homme qui n’a en vue que sa situation personnelle; il faut qu’il pense plus largement ou agisse hors de lui. Le monde ne se prosterne pas devant une idole par amour de l’idole, mais par amour de soi. Le véritable grand homme est celui qui a travaillé pour une idée qui le dépasse lui-même et dont la foule, inconsciemment, sent le caractère d’universalité.
Je prendrais volontiers le contre-pied de ce que X. disait tantôt à propos de certains auteurs contemporains qu’il louait d’avoir renoncé à ce qu’il appelle «le{90} romanesque» pour se consacrer à l’étude directe de la réalité, en exécutant de consciencieux et beaux travaux sur des sujets où leur imagination n’a rien à faire. Il louait B. d’avoir écrit seulement la biographie d’un homme, et il louait C. d’avoir écrit simplement l’histoire d’un saint. On a, disait-il, une tendance, de notre temps, à s’écarter du romanesque, autrement dit, de la fiction, pour se borner à rendre avec précision les faits.
Je soutenais, au contraire, que le talent proprement dit commence où il y a rudiment de fiction ou de romanesque, alors que, où la fiction ou le romanesque font défaut, il peut y avoir œuvre de chroniqueur ou d’historien excellent, mais non plus, à proprement parler, d’écrivain.
Sans doute, nous sommes dupes du mot: il y a un «romanesque» grossier, qui consiste simplement à accommoder des aventures ou à nouer et dénouer des intrigues dans le but de satisfaire un public fatigué ou niais. Mais il y a aussi un romanesque qui consiste à agencer les faits comme les idées, comme les impressions mêmes et comme les mots d’une façon caractéristique, saisissante, imprévue, ingénieuse. C’est justement l’invention. Le romanesque, c’est tout le mouvement personnel qu’un auteur exécute pour se dégager de la gangue qu’est la réalité, c’est tout ce que son génie ajoute aux apparences véridiques, c’est la part même du génie littéraire.{91}
Ce qu’on dit à propos de la morale, on le doit aussi bien entendre de la valeur des idées. Personne ne se préoccupe plus de la valeur intrinsèque d’une idée, d’une esthétique, d’une œuvre, mais de l’assentiment qu’elles obtiennent d’un nombre d’individus suffisant pour constituer une sorte de majorité. Ainsi, partout, en morale comme en spéculation, comme en politique, c’est le nombre qui règne et ce sont ses besoins ou ses caprices qui règlent la valeur. Sur toutes choses, celui qui fait métier de penseur, consulte les gens avant de savoir que penser: le directeur d’un journal consulte son public—qu’il devrait instruire; le romancier, l’auteur dramatique consultent leur public—à qui ils devraient imposer leurs conceptions; de même que le boutiquier pour demeurer honnête, et faisant son examen de conscience morale, mesure le degré de sa probité aux espaces qu’il a pu franchir impunément entre les divers règlements de police.{93}{92}
⬛
Je me souviens qu’un des plus intimes ravissements de ma vie m’a été donné à vingt ans par l’Angelico du Couvent de Saint-Marc. Plus que l’auteur de l’Imitation, Fra Giovanni a contenté en moi cet incompréhensible désir d’un amour sublime qui m’est tombé d’en haut quand j’étais tout enfant, dans une misérable ruelle de Beaumont, un jour que je montais en cabriolet à côté de mon père, à la seule vue d’une branche d’acacia fleuri. O mes promenades de jeune homme dans les cellules enfiévrées du vieux couvent des Bénédictins! stations, méditations, indicible joie, je n’ose dire «pleurs de joie!» devant l’Annonciation et la Descente de Jésus aux limbes!
Retour, à midi, dans cette petite salle du Chapitre où je n’ai jamais pu garder mon chapeau sur ma tête devant ce Christ en croix qui contemple les vingt saints pieusement agenouillés, en ayant l’air de penser que rien que ceux-là valaient déjà la peine qu’il mourût, ce Christ qui sur la croix semble plutôt reposer que souffrir, tant le bon peintre avait de répugnance{94} à le figurer autrement que libéré des misères humaines!
Après tant de temps écoulé, après un si grand bouleversement dans tout mon être, que mon visage s’est retourné, et que c’est en arrière et non plus en avant que je regarde à présent, je retrouve mon émotion de vingt ans devant la Déposition de croix du même Angelico, à l’Académie des Beaux-Arts.
Divin, oh! il faut le reconnaître, Jésus fut divin au moins une fois, c’est quand il inspira l’amour sans nom humain, de ce moine de Fiesole. C’est Fra Giovanni qui possède toute l’innocente sainteté, toute la suave pureté que souhaita l’idéal chrétien, et toute cette «charité» dont le tendre nom, plein de chastes baisers, devrait être donné à tout amour qui dépasse l’égoïste frénésie des sens. Franchement, je me méfie des transports de Thérèse d’Avila, et les fleurettes de François d’Assise me refusent obstinément leur parfum: le plus pur génie du Christianisme—la douce simplicité énamourée de l’Evangile—c’est dans l’Angelico qu’il m’apparaît. La couleur de l’Angelico est un miracle; elle m’attendrit; elle me fond; c’est une eau de baptême qui me lave; j’ai envie de sourire comme un petit enfant; je sens qu’elle efface mes péchés. Les bleus candides de ce ciel, les rouges charmants et le vert vieilli de la tunique de l’homme qui d’en haut soutient le corps de Jésus! et la naïve chair du Crucifié!
Ce Crucifié, âme du chef-d’œuvre, ce n’est pas en l’amenant en avant, ce n’est pas en l’éclairant plus{95} que les autres personnages, ce n’est pas par le prestige d’une auréole d’or ni d’aucun signe particulier, que le génial pinceau en a fait le centre d’une des plus fortes compositions qu’ait conçues un artiste, c’est en faisant de lui l’objet unique de la préoccupation, de la tendresse et de la douleur de tous. L’unité n’est pas dans les corps. Il ne s’agit pas de faire, à la Raphaël, ou même à la Titien, à la Véronèse, à la Rubens, une cohésion harmonieuse de mouvements, l’unité est dans les âmes; chacune d’elles pense plus qu’elle n’agit, chacune souffre, chacune aime, chacune pleure, et pour la même cause.
Voyez ces visages! ceux qui ne sont pas tournés vers Jésus parlent de lui, sont abîmés par la céleste tragédie accomplie. C’est un concert religieux, une fête de l’Adoration. Ce cher objet, ce corps de Jésus, tous ces gens venus là pour le descendre de la croix, ils osent à peine y toucher; ceux qui pourraient se rendre utiles à l’action et qui l’oublient à force de chagrin, concourent plus que les autres à en traduire la grandeur: leurs mains et leurs muscles défaillent de confusion respectueuse et d’amour! leurs esprits s’exaltent; je sens, j’entends tous ces cœurs qui battent pour une unique cause, pour l’amour de ce Dieu mort d’amour. Ce n’est qu’ici que j’ai vu, vraiment, le corps de Jésus descendre de la Croix.
Sobriété, simplicité, humble soumission à une idée dominante, à une noble idée, à une seule idée: précepte éternel de tout art.{96}
A côté de l’Angelico se trouve aujourd’hui, sur un chevalet la merveilleuse Adoration des Mages de Gentile. Sans doute, cela est meilleur, il y a là un dessin plus correct; il y a là une abondance, un sens du décor, un mouvement de personnages, une des premières divinations du rôle purement ornemental de la peinture, et aussi d’indication, déjà, de ce qu’un art peut perdre par le goût trop vif du perfectionnement de ses moyens. Des chevaux, des éléphants, des singes, un attrayant paysage, un cortège charmé de soi-même, des costumes somptueux couverts d’éclatants joyaux; des visages variés, animés, aimables, qui causent, qui rient, qui s’admirent, qui se complimentent; une foule heureuse de son propre nombre, flattée des incommodités mêmes d’un exceptionnel rendez-vous. La crèche est là, sans doute; c’est bien là le Messie, le Sauveur du Monde qui reçoit les hommages des Rois; mais comme on sait que l’événement divin n’est qu’un prétexte à la promenade d’un si beau monde! Pour combien d’autres raisons fussent-ils sortis de même, non moins chamarrés, non moins aises de prendre de l’air, d’exhiber de beaux habits, de cavalcader avec élégance! Que tout cela est joli, que je l’aime donc! De quelles délices légères un tel tableau est-il la promesse ou le symbole! Vie de relations, parures, parfums, sourires, jeux de l’esprit, joliesses du langage, amours aisées et non pas cruelles, souci charmant de toujours plaire, compromissions gracieuses, diminution bénévole de soi-même en faveur d’un groupe choisi, renoncement aux âpres{97} plaisirs de pousser sa cime libre et haute ou d’étaler ses encombrantes ou sauvages ramures, en faveur de la douce sécurité que donne le consentement à la taille commune, et l’urbanité à tout prix qui d’ordinaire écarte les orages de l’âme. Oh! qu’il me plaît de voir cette conception du gentil peintre de Fabriano côte à côte avec celle du religieux passionné de Fiesole! La vie méditative, solitaire, ardente et profonde, à côté du déploiement d’une société polie; le culte intime, un peu secret et jaloux, à côté des cérémonies renouvelées du paganisme ornemental, qui tiennent l’homme suspendu au prestige d’un rite symbolique, d’un décor ou d’un chant.
Pour moi, je sais bien de quel côté je me range, mais avec quelle complaisance je comprends que l’on s’attarde de celui-ci!...
Le plus beau des Botticelli c’est l’Annonciation qui est dans la petite salle des Maîtres anciens, aux Offices, en face d’une autre Annonciation de Léonard. Les subtilités affectées qui me rendent Botticelli insupportable à peu près partout, ont dépouillé ici leur maniérisme mondain pour se prêter à traduire, avec une finesse qu’aucun autre n’a égalée, la plus délicate scène de la légende chrétienne. L’attitude de l’Ange est plus belle que dans le Léonard d’en face, et ce n’est plus ici la naïveté souriante, candide, ineffable de l’Angelico: l’Ange est sérieux; tout en{98} lui est grave, on le sent pénétré de la grandeur de sa mission; c’est un être céleste conscient de Dieu et des hommes, et en même temps, qui est saisi de respect à l’approche de la jeune femme choisie pour accomplir le rapprochement inouï, l’inconcevable merveille, la fusion de la créature avec l’infini. Il vient d’aborder la Vierge; elle en est toute tremblante encore; cependant il a déjà prononcé le mot, et elle l’a compris. Elle est surprise, elle est confondue; elle voudrait que le moment qui vient de s’écouler n’eût jamais été; sa taille s’est renversée en arrière, ses mains font le geste d’éloigner s’il se peut encore la parole à laquelle on ne résiste pas; elle est sur le point de pleurer. Le silence de l’Ange, doublement respectueux et de l’ordre du Maître et de l’ébranlement qu’il vient de causer, l’épouvante; l’honneur et l’acceptation résignée quand même, chez la Vierge, suscitent un tragique divin, sublime et délicat, comme l’Antiquité n’en a pas connu, comme aucune œuvre humaine ne m’en a évoqué. Entre l’Ange et la Vierge, dans l’espace nu, plus sûrement qu’en aucun livre sacré, plus clairement qu’en aucun symbole, j’entends, jusqu’au tremblement, la parole de Dieu.
Il n’y a pas chez l’Angelico que la candeur d’âme et que l’Amour de Dieu. Aussi bien, l’idéalisme le plus touchant n’est pas fait que de pureté et que d’aspiration vers en haut, il est fait d’humaine vérité{99} exprimée sans recherche et presque sans y prendre garde. Un seul mot paysan ou populaire nous suggère mieux l’idée de la petitesse et de la grandeur de l’homme que le traité le plus savant ou que le plus merveilleux poème. Où l’Angelico surpasse l’altitude de son vol céleste, c’est lorsque, dans la peinture d’une scène sacrée, il introduit les expressions justes et bornées du visage humain, c’est-à-dire l’humble réalisme, de tous les moyens le plus efficace pour suggérer le sublime. C’est lorsque, voulant illustrer le miracle de la résurrection du Christ, il peint l’émoi divers des Saintes Femmes au Tombeau.—Une d’elles en croit à peine la parole de l’Ange qui affirme: «Il est ressuscité!», une seconde veut se rendre compte par elle-même; elle se penche au bord du sépulcre, une main sur ses yeux, en abat-jour, pour voir s’il est vraiment vide; une troisième, qui, elle, savait que l’événement devait arriver, sourit avec malignité; c’est celle qui pense, aujourd’hui encore, que les incrédules seront confondus. Une seule des femmes reçoit la nouvelle avec une foi pure, complète, tranquille comme un granit. Le mot «tragique» appliqué à une telle scène me paraîtrait bien faible: c’est la beauté, autrement robuste, de la Comédie humaine qui nous donne ici le frisson.—Et c’est lorsque, peignant la Présentation de Jésus au Temple, Fra Giovanni compose le visage du vieillard Siméon où se lit, en une écriture simple qui confondrait Le Vinci, tout le drame intime de l’homme en présence{100} de la Révélation. L’Angelico n’a pas peint le vieillard enthousiaste du Magnificat; il a peint un homme d’âge, sérieux, plein de bon sens et d’expérience, et qui en sait long sur les affaires humaines, un homme à qui on n’en compte point. C’est donc là, vraiment, le Messie, qu’on lui présente! Le Messie, c’est ce bambin qu’il tient, ce bambin pareil à beaucoup et qui ne pèse pas plus que ses pareils. Que ce bambin soit le Messie, c’est entendu, le vieillard ne dit pas non, mais, tout de même, la chose est un peu forte; il fronce les sourcils, il considère l’enfant, il réfléchit; il se remémore les Livres Saints, on voit qu’il pense aussi aux impostures possibles, il transperce l’enfant d’un regard aigu, presque pénible pour les témoins. On a envie de lui dire: «Oh! Voyons, pouvez-vous douter? Mais considérez donc la sainteté de la mère!» En effet, à côté de ce vieillard sceptique, la foi de la Mère tendant ses deux bras tout droits, d’un élan sans pensée, vers son enfant divin, a toute la force de cette mystérieuse sympathie qui nous rend si aisément confiants en certains êtres, et de cet étonnant besoin, inné au cœur de l’homme, de croire, chevaleresquement, ce qui n’est pas prouvé.
Une douzaine de tours quadrangulaires, frustes, élimées par les siècles, sans couronnement, sans toiture, calcinées, déchiquetées, vestiges d’un âge révolu, chicots d’une mâchoire de centenaire. Les courbes de{101} la route vous font jouer à cache-cache pendant trois kilomètres avec ces aspérités de la vieille ville recuite; on approche, on contourne de noires murailles, puis soudain vous voilà dans San Gimignano, lancé au galop des chevaux sur une de ces rampes dallées, et telles que l’on croit toujours n’en avoir jamais vu d’aussi raides.
Je suis resté longtemps à une fenêtre du Palais public, dans une salle où Dante est venu, dit-on, comme député de Florence, et devant une vue divisée par trois tours de taille inégale, mais d’un même ton de lichens roussis, et pomponnées de petites touffes d’une plante qui fleurit jaune au printemps et que l’on nomme violettes de Santa Fina. O les collines polies, qu’on voit à l’horizon! Là-bas c’est Florence, là-bas Volterra, là-bas Sienne où j’étais ce matin. Où ai-je vu pareille délicatesse de tous, pareille finesse de l’atmosphère? Ah! délicieux et subtils moments! minutes de cristal immaculé, les yeux charmés par de si doux objets anciens et par un horizon si délié; et l’âme toute ravie encore des deux Filippino Lippi qui sont exposés là!
Ce sont deux tondi qui se font pendant et composent à eux deux la scène de l’Annonciation, ce sujet incomparable, multiplié et toujours nouveau, où se mesure mieux que nulle part la qualité d’âme d’un peintre. J’en suis à me demander si cette Annonciation n’est pas plus belle que celle de Botticelli au Musée des Offices, pourtant si émue, Grand Dieu! et de quel{102} divin amour! Ici le drame est plus simple, plus un: l’Ange est seulement très grave: il tient sa fleur dans la main gauche, et il lève le doigt de l’autre main; il ne parle pas; l’objet de la mission est trop grand: un ange n’est là que pour préparer la Vierge à la parole de Dieu; et c’est Dieu lui-même qui parle de plus haut, par le moyen d’un rayon d’or. La Vierge est comblée d’émotion, elle accepte presque avec joie, mais sa main, son bras sur sa poitrine disent son respect, sa confusion immenses.
C’est par de si délicates représentations de ce mystère, que je sens le mieux la beauté du christianisme et son génie, la grandeur de l’idée divine et la dignité que confère à l’homme l’ineffable mélange consenti.
Dans la cathédrale de San-Gimignano, j’ai vu un martyre de Saint Sébastien, de Benozzo Gozzoli, qui me confirme dans ma vieille opinion, à savoir que Gozzoli est le plus grand peintre de l’Italie. Il y a là aussi des fresques tout à fait primitives, jeunes, gauches, d’une maladresse touchante, mais d’une imagination abondante et limpide, c’est l’Ancien Testament de Taddeo di Bartolo. En face sont les fresques du Nouveau Testament du Barna, peintre siennois: si inhabiles qu’elles soient, elles contiennent une rare émotion dramatique, et par-dessus tout cette unité d’actions qui est la plus grande marque de la force d’âme et de la probité d’un artiste. Personne n’a le temps de s’amuser, dans ces véritables peintures religieuses, tous les personnages sont occupés du{103} sujet; ils y prennent part avec passion, presque avec rage: c’est tout un peuple qui a l’air de savoir que l’Évangile sera composé de ses actes et qui, pour l’amour de Dieu, a hâte de les accomplir.
Mais la perle de San-Gimignano, c’est encore mon Gozzoli à Saint-Augustin. Il y a là un cortège qui me rappelle celui du Palais Riccardi et une mort de saint Augustin qui dépasse, à mon gré, les plus célèbres fresques, car outre l’harmonie des lignes, la beauté des attitudes, l’unité et la majesté de l’ensemble, il y a la sincérité, la simplicité et un certain air de vérité modeste et tranquille qui me paraît être la beauté même.
Un petit guide m’a conduit sur les tours des remparts; il a réveillé pour moi le vieux «custode» qui dormait; le vieux custode m’a ouvert une porte quatre ou cinq fois séculaire et toute bardée de ferraille; je me suis trouvé dans une petite cour vis-à-vis d’un porche croulant sous un lierre gigantesque; puis il m’a fait pénétrer dans un jardin clos de murs du XIIIᵉ siècle et où poussaient dans les plates-bandes ornées de buis, de l’herbe, des oignons et du blé; là j’ai penché la tête à la margelle d’une citerne antique; et le petit guide m’a donné à respirer une «herbe de senteur». Il faisait grand soleil et très chaud, un homme et une femme jardinaient, accroupis; ils se sont levés pour me souhaiter le bonjour; enfin je suis arrivé au bas d’un escalier étroit, aux marches rompues, et, entre le lierre et les lézards j’ai grimpé{104} jusqu’à une plate-forme carrée d’où la vue s’étend, en un cercle parfait, sur la Toscane. Là se respire, en vérité, un air d’une qualité rare; et la vague d’art et d’histoire qui se soulève à l’horizon pour mourir à mes pieds, remue plus d’images et crache une écume plus belle que la mer.{105}
⬛
25 juin 1895.
Je pense à tous les jardins que j’ai connus et à la volupté particulière qui m’est venue de chacun d’eux.
A Langeais—j’avais sept ou huit ans—l’ombre des marronniers roses, le sol nu sous ces feuillages trop épais, le mur de clôture crépi à la chaux et tout noirci. En face, la remise aux voitures qui me représentaient un peu de ma nostalgie d’alors: le déplacement, le voyage. Et, plus loin, la porte cochère dans laquelle s’ouvrait une petite porte; cela était l’endroit par où l’imprévu, l’inconnu pouvait venir. Je regardais toujours cette porte sur la rue; que n’ai-je pas espéré! qui n’ai-je pas attendu par là!
A Courance, le massif d’arbres verts, que l’on a détruit depuis longtemps. Il renfermait un plant d’asperges et mon jardin particulier, espace de deux mètres sur trois, obtenu à la suite de longues et difficiles discussions. Mais, au delà du petit cours d’eau presque toujours à sec, le potager, sa pompe fixée sur{106} un lourd pilier de pierres qu’une touffe énorme de chèvrefeuille jaunissait; les grands arrosoirs trop lourds, la planche humide, gluante, où ils recevaient l’eau par un «raccord» de fer-blanc inséré dans le tuyau de fonte; les petits «timbres» réservés aux abeilles, sortes d’épaisses et lourdes assiettes de pierre dure hérissée de quatre oreilles grossières par quoi on soulevait ces vasques étranges. Les abeilles, par centaines, venaient tomber là comme des balles dorées, puis se faisaient plus légères en se promenant au bord de l’eau; elles s’inclinaient, accrochées à la paroi moussue, ayant la taille si fine qu’elles paraissaient coupées en deux, et leur tête lourde effleurait la surface de l’eau. Cela sentait une odeur de poireau ou d’oignon, de lilas, au printemps, quand ce n’était pas de cantharides.
Le jardin, le potager plutôt me revient continuellement à la mémoire; j’en repousse l’image lorsque j’ai à décrire une maison de campagne, parce que c’est lui toujours que je ferais revivre. C’est cet enclos qui obsède mes souvenirs d’enfance.
Mais c’est le jardin du Luxembourg qui est le décor obligatoire de l’autre partie de ma vie.
De ma vie, ce Luxembourg a déjà contenu dix ans; et les années de métamorphose. C’est sur la terrasse des Reines que j’ai réellement débarqué de ma province. Toute mon enfance, j’avais vécu au jardin. Ici, j’ai continué. J’y venais le matin; j’y passais les plus belles heures de l’après-midi. Si j’ai manqué{107} beaucoup de cours, c’était moins pour faire des folies que pour venir là, là où j’étais dehors, là où je «prenais l’air» comme on me l’avait tant recommandé, et là où j’ai contracté le goût des longs bavardages. C’est là encore que j’ai cultivé cette rêverie devant les hommes qui passent, que j’entends passer et qui semblent là jouer pour moi la comédie. A l’ombre des aubépines ou des lauriers, adossé ou accoudé à la balustrade, quand j’étais seul, que d’histoires, que de petits drames j’ai vu se former, se nouer, se dénouer sur ce gravier pénible aux pieds et sous ces arbres à musique militaire!
Un jour j’ai arpenté d’un pas vainqueur ce même gravier en me disant: «Je ne reconnais rien; personne ne peut me reconnaître...» C’était au retour d’une période de vacances où j’étais tombé pour la première fois sérieusement amoureux.
D’ailleurs, pour la seule joie des yeux, pour le simple plaisir d’une belle heure qui s’écoule, ce Luxembourg est incomparable. En ce moment je m’y baigne la vue fatiguée de musées et de lectures, sur la grise douceur des tours de Saint-Sulpice, sur le vert enfoui des grands platanes du groupe Delacroix, sur le nuage attendri de l’eau qui s’élève, en poussière multicolore, des tuyaux d’arrosage. Des géraniums, points écarlates, avivent cette belle mollesse, et l’or du soleil baissant sur les marronniers déjà roux enferme le tout dans un cadre vieilli. Des fluidités à la Corot dans tous ces arbres de la terrasse opposée. Quant{108} au Palais, je ne sais pourquoi, il est pour moi chose morte; je ne le vois jamais; je viens de m’apercevoir que je ne l’ai jamais regardé.
L’autre jour, entre les gaufres et le kiosque à musique, j’ai vu Maurice Barrès, à califourchon sur une chaise. Il a regardé dix minutes le soleil couchant. Pas une fois il n’a regardé quelqu’un. Il était coiffé d’un canotier et vêtu de gris clair. Quelle belle tête il a! Mais on l’aurait cru là un hôte de passage, descendu d’une planète étrangère. Je crois qu’il n’a pas vu le Luxembourg: il était venu pour le soleil.
23 avril 1901.
Ma première visite avec ma femme, je l’ai faite à la maison des Goncourt, à Auteuil. Nous l’avons cherchée dimanche dernier, après-midi, par un beau temps. Les affiches nous l’ont désignée extérieurement.
Nous avons vu Pélagie. En entrant, on remarque tout de suite, sur un de ces murs qui portent tant d’exquises merveilles, un énorme chromo représentant une femme souriante qui montre de belles dents, et, en face, au pied de l’escalier, deux morceaux de jambons pendus à un clou par une ficelle. Ce sont des morceaux de jambon auxquels on s’approvisionne chaque jour. On y coupe à même, comme à la campagne. Le jambon, ce chromo, et la malpropreté{109} sordide de tous les objets laissés à la disposition de Pélagie, c’est tout ce qui demeure de remarquable dans cette célèbre maison. Si. Nous avons vu, à la place de l’ancienne table de toilette d’Edmond de Goncourt, la toilette en cristal d’Allemagne qui a été attribuée à Pélagie, et qui a fait envie à Alice[M]. Tout le reste de ces murs est désolant. De l’andrinople déchirée par les clous, salie par la poussière. Des rayons de bibliothèque un peu partout, jusque dans la salle de bains. Et dans ce grenier désolé, malgré tout je n’ai pu retenir un frisson, en pensant à toutes les voix qui ont retenti entre ces murs étroits: la voix charmante de Daudet que j’ai entendue, la grande voix de Flaubert que je crois avoir entendue, celle de Goncourt que je n’imagine même pas, car je ne vois plus chez lui que l’œil, caressant un objet matériel, et la main signifiant l’impression qu’il en reçoit.
29 avril 1901.
Ma pauvre petite femme est couchée dans cette chambre hier si gaie, si charmante, et si pleine de mon nouveau bonheur. De cette chambre, on a bouché les vitres avec des morceaux de papier d’emballage, et caché les clairs rideaux de mousseline blanche à dessins bleus avec de grands voiles d’andrinople.{110} Un paravent intercepte encore le jour des deux chambres voisines. Et dans cette nuit, on aperçoit le visage de plâtre, la petite figure de pierrot de ma pauvre chérie, qui souffre la privation de la lumière de mai, et qui, sous son petit front, appréhende de demeurer sa vie entière défigurée! Pauvre enfant, si heureuse d’éprouver et d’orner sa jeunesse, subira-t-elle ce supplice? Et tout au fond de l’angoisse que je sens dans son cœur, surgit la crainte d’être moins aimée de moi. Comment lui dire que je l’en aimerais davantage? ou plutôt, comment le lui faire croire? Pour une femme, il n’y a pas d’épreuve plus terrible, et je vois bien que cela seul l’affecte dans sa maladie. Elle eût bien courageusement affronté la mort, mais elle fléchit devant la perspective d’être laide. O mon Dieu! prenez-nous en pitié! De ma vie, je ne me suis senti si profondément malheureux.
24 mars 1902.
Je réfléchissais au besoin que j’ai, quand je suis seul témoin de quelque chose, ou seul à contempler un paysage, de mentir un peu, soit en exagérant le charme que j’éprouve, soit en forçant mon mécontentement. Mais toute ma littérature, et il faudrait dire toute la littérature, vient de là. Ce n’est pas travestir la vérité, c’est trouver la raison suffisante à parler de cette vérité. Car énoncer simplement ce qui{111} est, quelle misère! Mais si je suis enthousiaste ou haineux, à la bonne heure!
En face de quelqu’un, je ne suis plus à l’aise. Un témoin me coupe les ailes. Je n’ose mentir devant lui. Et je pense sans cesse à ce que je lui eusse dit plus tard, en le rencontrant, des choses que nous avons vues ensemble et que nous avons tous deux jugées ordinaires, mais que j’aurais transformées. C’est pourquoi je n’ai jamais d’exaltation en compagnie. Je ne suis poète que dans la solitude.
Août 1903.
Commencer mon roman par la rentrée à Paris en octobre. Se rappeler la volupté incomparable d’errer dans Paris pluvieux ou ensoleillé de cette époque, et l’heure où s’allument les lumières, etc. Déjà, dans l’esprit du héros, l’espoir immense et vague de trouver quelqu’un ou quelque chose à chaque tournant de rue, qui déterminera sa vie.
Dans mon roman, penser à l’amitié. Celui qui aime et celui qui est aimé[N].
Août 1903.
Les idées ne naissent pas (pour moi) spontanément, elles sont reliées entre elles; elles se développent{112} comme une phrase musicale (le contrepoint si je ne me trompe) selon une logique. De là vient que l’on traverse des périodes vides, et que l’on est ramené à des périodes fécondes, soit par une conversation, soit par une lecture. La lecture me fournit des idées à côté, très différentes quelquefois de celles que je rencontre, mais qui ont reçu de ces dernières la chiquenaude qu’il fallait pour qu’elles fussent mises à jour.
28 septembre 1903.
Très beau temps. Nous sommes dans notre installation. Vie intelligente suspendue. Je ne m’occupe que de savoir l’effet d’un tapis, d’une portière. Mon imagination s’épuise à juger a priori d’une chaise à tel endroit, d’une bibliothèque à tel autre. Combien de jours de ma vie que je n’ai pas notés, et qui ont été consumés en préoccupations de cet ordre! Que d’installations déjà!
Comme je suis sans cesse troublé par les horreurs que nous apportent les échos de la politique odieuse qui sévit, comme je ne sens que trouble inexplicable toutes les fois que je veux m’en mêler, je voudrais adopter et pratiquer le précepte de Renan: «Noli me tangere, c’est tout ce qu’on peut demander à la démocratie.» La préoccupation sociale troublera mon œuvre, si je n’y mets pas bon ordre, et lui enlèvera le caractère d’aisance et de liberté que j’aurais tant aimé qu’elle eût.{113}
2 octobre 1903.
Quand je suis tourmenté d’un roman, dans tout ce que je lis, dans tout spectacle auquel j’assiste, je saisis sans m’en apercevoir, avec une avidité de chasseur, tout ce qui peut avoir de près ou de loin un rapport avec ma chose, tout ce qui peut me mettre sur une voie, m’élancer. Beaucoup de choses ont cette vertu de m’élancer seulement. La musique, par exemple. C’est une sorte de nourriture; et l’on voit bien, dans ces moments-là, comment une œuvre s’exécute, comme un nid d’oiseaux, avec mille bribes, mais transformées et presque digérées, assimilées, rendues méconnaissables.
Dimanche, 4 octobre 1903.
Vent, pluie. Avons été déjeuner chez Foyot, puis à l’Odéon voir Résurrection de Tolstoï.
Il y a de bons le second acte: la délibération du jury, encore qu’un peu grossière, et le troisième acte (ou second acte après le prologue): la scène de la prison de femmes. Le prince voulant sauver la Maslowa et la trouvant complètement dénaturée par la vie de prostituée, cela est juste et fort. Le reste est rêvasserie. Comment admettre qu’une fille, tombée au dernier degré de l’abjection, en deux jours à peine soit déjà redevenue honnête et chaste parce qu’on a obtenu son transfert à l’infirmerie?{114}
Et puis, qu’est-ce que ce rachat? qu’est-ce que cette entreprise? que nous chante-t-on avec ce devoir d’un homme de consacrer toute sa vie à une créature dont il a été, je le veux bien, la cause initiale du malheur? Il a été la cause. Mais la jeune fille n’était donc pour rien dans sa propre chute? L’a-t-il donc violée? Ne savait-elle pas qu’il était prince et qu’il ne réparerait pas en justes noces son mouvement de folie? Et une jeune fille qui se laisse prendre ainsi n’est-elle pas responsable? «Je veux m’en aller!» dit-elle; et comme il est plus doux de rester dans les bras du jeune homme, elle y reste. Mais lui est un séducteur, un être qui répand l’amour, un de ces fléaux chéris qui parcourent le monde et en sont une des forces. Elle manque de volonté, c’est une petite niaise qui devrait se souvenir des préceptes qu’on lui a certainement fournis. La coupable, c’est sa faiblesse, si coupable il y a. Et il faut qu’un homme qui a un rôle social à remplir, qui nous est présenté comme étant sur le point de fonder une famille, qui est aimé d’une jeune fille honorable, fasse le malheur de cette autre jeune fille qui vaut bien la première, pour racheter cette Maslowa? Il faut qu’il s’anéantisse, qu’il passe sa vie avec des condamnés, avec des nihilistes, etc., pour ressusciter une malheureuse prostituée?
Ce sentiment de la responsabilité que l’on inculque de nos jours un peu partout, est en train d’enlever à l’homme tout esprit d’initiative et d’entreprise. C’est un affaiblissement moral, ce n’est pas une beauté ni{115} un progrès moral. Dans toute action, il y a une responsabilité à encourir: l’envisager d’avance, c’est renoncer à agir. Je n’oserais pas faire monter un couvreur sur ma maison, si je pensais au danger qu’il court et que je puis avoir une mort d’homme à me reprocher. Si cet homme meurt à mon service, dois-je aussi épouser sa veuve?
J’aime à penser à la belle désinvolture de nos pères vis-à-vis surtout des choses de l’amour. L’amour, en somme, n’est-il pas plutôt un bien? Et le fait de donner un enfant à une fille, malgré toute la misère qui en peut résulter, n’est-il pas encore un acte louable? C’est à considérer. Mais je suis frappé de ce que le dernier des misérables est encore attaché à la vie et la préfère au néant. Créer un être vivant, n’importe où, n’importe comment, n’est-ce pas bien agir? Et puis, l’amour est une puissance incontenable. Il doit être ainsi. L’endiguer, c’est lutter contre le soleil. Comme le soleil, il fait vivre.
Je suis sorti de ce drame l’âme noire comme la nuit. Que le diable emporte les Russes! Je relirai ce soir Brantôme.
10 octobre 1903.
Temps splendide.
Écrit, la matinée.
Jules Lemaître explique, timidement, ses opinions presque royalistes.{116}
Sorti après-midi à pied. Agrément de l’avenue du Bois de Boulogne.
Lu Maison de Poupée. Toujours la même impression d’une chose étrangère, et même ennemie, que j’ai sans cesse ressentie en voyant jouer de l’Ibsen. Quelle nuit et quel ennui dans ces cervelles! Et comme c’est mal fait! Eh! mon Dieu, si c’était seulement bien fait, on comprendrait et on accepterait peut-être. Je ne vois pas d’opposition à admettre qu’une jeune femme se révolte d’avoir toujours été traitée en enfant, en poupée; à la rigueur qu’elle invoque ses droits à l’affranchissement, «à se rendre compte de tout par elle-même», à juger par elle-même de la valeur de la loi morale et de la religion! Mon Dieu, ce sont là des sottises que nous lisons ou voyons tous les jours. Mais encore faudrait-il que cela soit «la pièce», que cela fasse l’objet de quelque développement, de quelque discussion! Cela vient à la fin, comme des cheveux sur la soupe; on ne s’attend point à cela: nous avons perdu notre temps durant trois actes à nous occuper d’une affaire de faux qui n’a en réalité aucune importance, ni moralement, ni dramatiquement, puisque ce faux, commis par Nora, est très excusable et puisqu’il est presque aussitôt pardonné que connu. Il fallait être averti que Nora n’avait que les apparences d’une femme étourdie, d’«un petit oiseau chanteur,» or nous la croyons bien telle tout le temps, et pour ma part je persiste à croire qu’elle est même un peu toquée, du commencement où elle ment{117} pour le plaisir, en faisant croire à Mᵐᵉ Linde qu’elle s’est procuré de l’argent par la galanterie, jusqu’à la fin où elle abandonne mari et enfant, du diable si je sais pourquoi!
Dimanche, 18 (octobre) 1903.
Pluie.
Sommes allés Concert Colonne. Symphonie fantastique et Neuvième symphonie, avec chœurs.
Ces concerts sont extrêmement fatigants. Cela commence à deux heures et quart et finit à cinq heures et quart sans que l’on ait seulement cinq minutes de répit. On a perdu complètement de vue le but de l’art qui est de vous donner un plaisir élevé, mais un plaisir. Tout prend de nos jours l’aspect «scientifique» et pédant. On ne va pas entendre de la musique pour son agrément, mais pour se documenter, pour apprendre. On devient très fort, et les compositeurs, entraînés par le mouvement, n’accomplissent plus que des tours de force. Il en est de même pour tous les arts: ce qui n’a point l’aspect scientifique est peu coté.
Dimanche, 6 décembre 1903.
Nous sommes allés en automobile faire visite aux M. à Saint-Cloud. Paysage d’hiver charmant dans le bois de Boulogne. Que le tapis de feuilles mortes est joli! C’est d’un cuivre violacé, d’une couleur très{118} rare, et le dessin des arbres est si vigoureux et si beau, dépouillé.—Recherche du verger, dans la rue(?) de Buzenval à Saint-Cloud. De loin, par-dessus les enclos, les vergers, on distingue la maison simple, un peu anglaise, au toit rouge, bas, aux larges baies vitrées, à l’absence presque prétentieuse de toute prétention. L’intérieur est vraiment bien. Tout y est combiné pour un heureux effet et un plaisir discret des yeux. Un beau Cottet, un délicieux La Touche. Les maîtres de céans, hospitaliers et buveurs de thé, à l’anglaise, sont des bêcheurs forcenés des confrères en littérature—parce que nous ne parlons que littérature. Éreintement de P. A., éreintement de R. M. fonde une revue.
Visite au retour chez Hennique. Il me parle de son ennui à lire des monceaux de livres de jeunes, pour le prix Goncourt qui va être décerné ces jours-ci. Je l’oblige à en lire un de plus, celui de Villetard. Il ne devait pas y avoir de candidatures, mais il s’en produit, paraît-il, notamment celle de M..., et d’une façon des plus impératives. Et il arrivera qu’on donnera le prix à celui qui l’aura le plus audacieusement demandé. C’est dans l’ordre. C’est du réalisme.
Je dis à Hennique que je ne puis pas admirer Germinie Lacerteux. Pour moi, Germinie est une basse et inférieure réplique de Madame Bovary. C’est le même sujet: l’enlisement progressif d’une femme. Seulement Goncourt est parti de plus bas, et s’est enfoncé jusqu’à la limite de l’ignoble. Après cela, Zola partira de là pour s’embourber dans l’ordure, pour{119} l’ordure. Seulement Madame Bovary est en même temps que l’histoire d’une femme qui s’enlise, la peinture accomplie d’un monde, de caractères variés, animés, typiques et impérissables. Seulement Madame Bovary est un cas simple, ordinaire, général, qui n’a pas été cherché, qui se présente au poète comme un coin de pays au peintre. Germinie, on a été la prendre, pour ne pas faire comme tout le monde, pour peindre quelque chose qui n’avait pas été peint. Et pour ne pas faire comme tout le monde, on l’a faite monotonément sombre, atroce, répugnante, outrageusement dégradée. C’est fait avec une honorable conscience, un travail soutenu, sérieux, ennuyeux comme la scie. Et il n’y a qu’un type, qu’une figure, mais on s’enorgueillit de l’avoir fouillée. Elle ne valait pas tant d’honneur. C’est une œuvre de parti pris, non une œuvre simple et spontanée, comme Madame Bovary. Et remarque-t-on que Madame Bovary est de 1857, et Germinie de 1862? On appelle Goncourt un initiateur (auj. même le Soleil 6 décembre par Léon Daudet).
Hennique préfère Germinie à la Bovary. Voilà l’esprit académique, ou sous-académique, qui fera louer sans cesse les fondateurs, Goncourt comme Richelieu.
30 janvier 1904.
Chez Bing, après-midi, voir la collection Gillot. Objets japonais. Merveilleuses boîtes de médecine ou{120} petites trousses en laque d’or. Grandes boîtes écritoires avec paysages. Une superbe tête de femme ou vierge diadémée qui rappelle par la majesté sereine le plus bel art grec—avec quelque chose de plus: un recueillement douloureux un peu. Des poteries, des faïences dont les formes et les couleurs dénoncent l’imitation assez clandestine qu’en font nos modernes artistes. Tout l’art nouveau est dans cet art libre japonais. J’admire profondément cet art délicat et si intimement fondé sur la sensibilité et le sentiment de l’équilibre. Point de symétrie, comme dans le décor grec, romain, roman, gothique même ou de la Renaissance, mais un équilibre aux principes insaisissables et dont on ne peut que constater l’heureux résultat. Un arbre d’or jeté tout d’un côté d’une petite boîte et l’autre partie vide, toute noire: et ça tient, c’est composé. C’est un équilibre parfait. Leur sensibilité leur donne la divination du sens de la vie; leurs animaux sont chauds; on les sent respirer. Et quelle imagination appropriée—dans l’art tout est là—imagination purement pittoresque: des libellules au travers d’un champ d’herbes à demi foulées; des filets étendus sur des pieux; des motifs tirés des cristaux de neige, etc. Quels peignes délicats et légers que nos modernes stylistes ont copiés grossièrement! C’est l’art le plus près de nous, le plus touchant.
J’ai eu le plaisir de rencontrer au milieu de ces objets charmants cet artiste charmant qu’est Henri de{121} Régnier. Nous avons reparcouru ensemble toutes ces merveilles. Je l’ai emmené au Café de la Paix. Avons causé jusqu’à six heures. Une aimable politesse le fait acquiescer à ce qu’on lui dit, de la voix, de la tête, et d’un geste à lui particulier des deux bras qui viennent simultanément en avant comme au-devant de votre opinion; et s’il fait des réserves, c’est avec retenue, mais il est ferme pour ce à quoi il tient. On devine qu’il y a un certain nombre de choses déterminées qu’il défendrait, mais il a une complaisance naturelle. Il cite assez régulièrement quelque anecdote narrée jadis par Mallarmé: c’est un culte fervent qu’il lui rend. Il a un tout petit monocle cerclé d’écaille et fiché dans l’orbite gauche si je ne me trompe, mais qui en tombe facilement. J’aime assez ses yeux qui ne tiennent pas à être expressifs, mais qui ont de la finesse et de la beauté. Il a une bouche et un menton singuliers: la bouche arquée en masque tragique, le menton fort et démesurément allongé; l’ensemble en est lourd et semble propre à prononcer ses périodes qui sont belles mais jamais légères.
Le soir, été aux «Variétés» voir une revue de Gavault. Images amusantes de Max Dearly en Delcassé, et en voyou parisien au parterre, en chauffeur d’une automobile faite de caisses d’emballage. Max Dearly a un physique, des mouvements, une mimique et une imagination très originaux et extrêmement amusants.{122}
9 février 1904.
Banquet Edmund Gosse, chez Durand.—J’ai été invité à ce dîner par Edmund Gosse lui-même qui m’a fait un excellent article dans la Daily Chronicle. Je lui ai été présenté hier soir chez Édouard Rod, et il m’a fait un accueil charmant; je sens qu’il aime beaucoup mes livres.
Chez Durand, réunion un peu hétéroclite, bariolage amusant. Faguet préside, il a à sa gauche un éditeur anglais, à sa droite M. Gosse qui lui-même est assis à un mètre environ de Rodin. Il y a quatre personnes à cette table d’honneur immense. Puis on s’installe comme on peut. Nous sommes 37. Barrès est assis entre Marcel Prévost et un M. Gillet, gendre de Doumic. Barrès a un peu vieilli, quoiqu’il garde de loin l’aspect jeune qui semble faire partie de son attitude. Il a dans la chair des bouffissures, comme des parties meurtries de fruit trop tâté aux doigts. Il a une belle tête délicate qui aurait servi à un jeu de boules d’hommes politiques. Les yeux sont particulièrement fatigués; mais il conserve le cheveu noir intact. Il mange peu, il se tient à table les deux mains dans les poches du pantalon, fort dédaigneux des mots et des gens. Pendant que Faguet parle, Barrès a sorti une main du gousset et prend devant lui chacun des cinq verres demeurés pleins de vins différents; il les respire et les repose successivement devant lui sans y toucher, puis finit par boire un verre d’eau.{123} En arrivant, sa première parole avait été, s’adressant à Rod: «A quelle heure est-ce que ce sera terminé?»
Discours de Faguet, avec des minauderies non point sottes, mais qui semblent un peu d’emprunt, comme les facéties dont il égaie ses articles du Gaulois. Le discours de Gosse a été admirable, quelque chose d’inattendu, d’unique. Une saveur de simplicité, de bonhomie, d’esprit naturel qui sent le Montaigne et en général l’homme du XVIᵉ siècle. Uzanne, qui dîne à côté de moi, dit que c’est l’humour anglais; mais peut-être faut-il remarquer que M. Gosse est d’origine française, expulsé par la Révocation de l’Édit de Nantes, et il semble être un bonhomme de ce temps-là qui reparaîtrait tout à coup chez nous, intact.
Faguet, après le dîner, a déboutonné son gilet, la patte de sa chemise est sortie; il cause, cause, s’emballe; sa voix de tête siffle comme la flûte, et il est obligé de prendre un point d’appui contre la table du salon où sont de nombreuses tasses de café qu’il renverse à plusieurs reprises. Il confond Henri Bordeaux avec Marcel Prévost.
Doumic s’est fait présenter à moi par Rod; il me dit l’admiration qu’a pour mes ouvrages son beau-frère Jean Veber.
29 mars 1904.
J’ai voulu voir Monsieur Bergeret au théâtre (Le Mannequin d’osier). On disait que Guitry y avait{124} créé une figure inoubliable. Je n’ai pas connu de soirée aussi vide. Quelle naïveté de penser que l’on puisse porter sur la scène un ouvrage qui n’est qu’une causerie humoristique! Il n’y a point de personnages chez Anatole France. Il y a un homme qui cause agréablement à propos de tout, et il y a de temps en temps des figures sans importance, et sans lien, bien entendu, avec une action dramatique quelconque (puisqu’il n’y en a point) mais qui viennent soutenir le dire du causeur principal en lui prêtant soit le secours de leurs réflexions ingénieuses, soit le charme de leur physionomie pittoresque. Le théâtre jette sur ces fantoches inviables une lumière d’une crudité impitoyable et qui les boit, les anéantit, comme un rayon de soleil une culture d’infiniment petits. C’est en vain qu’on a cherché à mettre ce pauvre Bergeret debout. Ou il est inexistant (et c’est mon opinion) ou il est un monstre d’imbécillité. On élimine du livre tout ce qui en est l’élément intellectuel, à savoir les développements de rhétorique subtile; et ce qui demeure est au-dessous de la conception du plus plat vaudevilliste.
Nice, 10 avril 1904.
Promenade au château: aspect «dantesque» de l’allée montante du côté de l’Est: oliviers, cyprès et bancs de granit d’une forme massive qui a presque un style, petit cirque avec bancs de pierre: un décor{125} de Champs-Élysées pour personnages très graves et capables de goûter l’aridité noble du paysage. Un ruisseau d’eau pure coule du haut de la montagne cependant, mais sans enlever aux alentours l’aspect sec et battu des vents. En haut, j’ai vu un moment un beau décor: un vieux puits, un mur en ruine, un beau pin et un paon superbe. Un coup de canon a retenti, c’est midi; des cris de paons ont retenti au loin, le paon s’est dressé, a poussé trois grands cris et s’est mis à développer sa queue magnifique. Ces paons saluant le milieu du jour dans ce décor de poème m’ont touché.
Avril 1904.
Quelle sentimentalité niaise et antipathique pour nous que celle du XVIIIᵉ siècle! Diderot, après la mort de son père, regrette qu’il n’ait pas laissé de portrait, et il écrit à Mademoiselle Voland: «Si ses infirmités lui eussent permis de venir à Paris, mon dessein était de le faire représenter à son établi, dans ses habits d’ouvrier, la tête nue, les yeux levés vers le ciel, et la main étendue sur le front de la petite fille qu’il aurait bénie.»
18 avril 1904.
Partis de Nice après déjeuner, par l’Estérel. Belles vues, route sinueuse, et jolie descente sur Fréjus;{126} l’aqueduc romain. Nous arrivons à la nuit à Pioule. Très bon hôtel d’établissement thermal où il n’y a qu’une vieille dame pensionnaire, de quatre-vingt-dix ans, qui dîne seule et qui dit en se retirant: «Oh! je vais me coucher avec un bonheur...» Cette expression chez cette ruine d’être humain, pour qui le lit menace chaque soir d’être la tombe, et qui, pourtant, est sincère et sans arrière-pensée, a quelque chose de naïf et de touchant. Tout le monde sourit; je regarde s’en aller la bonne femme; et son mot, pour moi, retentit autour de sa tête branlante.
20 avril 1904.
Matinée superbe; soleil, chaleur, pas de vent. Nous allons visiter Villeneuve-lès-Avignon par un petit omnibus antédiluvien, qui manque trois fois de nous verser dans la boue épaisse de dix centimètres qu’a formée la pluie diluvienne de la nuit. Nous pataugeons dans un village sordide niché dans les ruines d’une abbaye de chartreux. Puis visite du Musée, sans importance, conduits par une bonne religieuse épanouie et de bonne humeur; joli coup d’œil sur un jardinet de couvent planté d’arbres, avec des fleurs en pots. L’après-midi, nous décidons d’aller voir la fontaine de Vaucluse et les Baux que nous n’avons pu voir hier.
Vaucluse: déjeuner sous une tonnelle fraîche d’où{127} l’on voit une grande roue de moulin, velue de mousse, qui tourne en versant à mesure des boîtes remplies d’eau sur un mur de mousse. Nous mangeons de ces truites qu’appréciait Pétrarque et qui, avec l’ombre, forment le blason de la ville; on a pris les truites devant nous, dans un vivier, sous l’œil d’une hôtesse assez gentille et jolie brune.
Après déjeuner nous allons à la Source de la Sorgue; on prend un petit chemin sur la rive droite de la rivière, en vue des ruines fort belles du château de Cavaillon. Ce ne sont d’abord que guinguettes et petites baraques où se vendent des cartes postales et souvenirs de Vaucluse, des usines de lamentable aspect et qui semblent ruiner complètement le paysage; les rochers sont couverts littéralement d’inscriptions, peints, à coups de pinceau trempé dans une sorte de cirage liquide; c’est désolant et l’on voudrait retourner pour ne pas assister plus longtemps à la profanation d’un lieu si riche de souvenirs. Mais tout à coup cessent les guinguettes, les baraques et les rochers à portée de la main; le cirque s’élargit et l’on se trouve en présence de rocs taillés à pic sur deux cents mètres de hauteur; un grand trou sombre à la base, des plantes d’eau couchées sur des roches, pas d’eau, mais le plus grandiose paysage. En se retournant, un autre cirque lointain de deux kilomètres, irisé de gradins naturels formés par des bandes de végétation parallèles. Le château de Cavaillon sur la gauche, semblable au rocher; des dents de roc perpendiculaires; et l’énormité{128} du rocher de deux cents mètres à pic, au-dessus de votre tête. C’est très grand, très beau. Je ne regrette pas que la source n’ait point bouillonné, car sa vue est assurément moins belle que celle du paysage.
Une femme jeune est montée par le sentier, pendant que j’étais là; elle était jolie, elle avait des yeux noirs splendides, et la gravité, cette rare gravité amoureuse et hautaine dont l’on doit être imprégné quand on sent la poésie de Pétrarque. De tels yeux, une telle beauté, un tel caractère, je ne les ai pas rencontrés trois fois dans ma vie; il est vraiment curieux qu’ils me soient apparus à cet endroit, à l’heure même où je pensais aux énigmatiques amours de Pétrarque et de Laure, dont l’expression poétique fut à coup sûr empreinte de cette religieuse gravité qui fut toujours l’accompagnement chez moi de la passion amoureuse. Qui était cette femme? Elle avait un petit enfant; son mari l’accompagnait; ils semblaient de petite bourgeoisie; elle était nerveuse, car elle ne put approcher du gouffre, et elle cria: «Prends garde au petit enfant!» avec l’accent du pays. Elle ne regardait rien; elle était certainement insensible aux choses de la nature qui l’environnaient; elle était sensible aux regards d’un étranger qui la regardait avec admiration. Ce devait être une femme très ordinaire qui eût été très capable d’inspirer un grand amour, en un pareil moment, à un poète. Que fut Laure?{129}
Cet endroit, cette apparition étonnante et si convenable à l’heure, au lieu et à mon âme, m’ont rempli de trouble. C’est là que Pétrarque s’est recueilli, là seulement qu’il a pu écrire, là peut-être qu’il a surtout aimé, à la manière dont il aima, un peu loin de l’objet aimé.
5 mai 1904.
Je suis allé voir Rebell qui est au plus bas de la détresse. Il est épuisé par une maladie d’intestins qui l’a réduit à la peau et aux os; il a un épanchement de synovie compliqué de rhumatismes, qui le fait souffrir, le prive de sommeil, et l’empêche de faire un pas. Il a reçu une assignation de vente de son mobilier pour demain; il est poursuivi par son libraire à qui il doit de l’argent. Je lui remets ce que je puis; mais comme la chose se répète depuis plus d’un an, cela en pourrait devenir une habitude et j’ai pris le parti de le lui dire. Il comprend bien. J’ose lui donner le conseil de ne pas conserver le lourd loyer qu’il a. Sans ressources, peut-on demeurer dans un appartement de près de deux mille francs? Il comprend bien. Il ferait mieux, me dit-il, de prendre un appartement à Versailles.
—Parfait, voulez-vous que je vous en cherche un?
—Oui, j’aimerais assez quelque chose ayant vue sur le parc.
—Fichtre!{130}
—Ou bien une petite maison à la campagne... L’inconvénient, c’est mes livres. Ne pourrais-je pas, si je m’en vais, louer à Montmartre un grand atelier où les déposer?»
Ainsi, réduit à la dernière extrémité, il envisage comme suprême recul une maison de campagne, une vue sur le parc de Versailles et, en plus, un atelier à Montmartre, total, deux loyers au lieu d’un. Je l’ai engagé à rester tranquille. Il ira en référé; il obtiendra de son propriétaire deux mois de sursis.—Et après? Après? Mais il sera guéri d’ici là, il touchera ceci et cela, il sera tiré d’embarras, il n’en doute pas. En l’écoutant je retrouve le Prosper Quinqueton d’une nouvelle que j’ai écrite ces mois derniers. Je n’avais jamais entendu les réponses que fait Prosper Quinqueton à l’ami qui est venu le secourir; je les ai entendues aujourd’hui.
Je suis allé à cinq heures au jardin du Luxembourg. Je provoque peu à peu la nostalgie dont j’ai besoin pour écrire mon roman sur cet endroit[O]. J’ai besoin d’éprouver la nostalgie des lieux que je veux faire vivre. Il faut les avoir quittés. J’ai regardé en passant les trois petites fenêtres de l’appartement que j’ai habité, rue de la Harpe. Passer dans le sillon que ma vie a creusé, est pour moi une volupté triste et exquise, une émotion d’une qualité incomparable.{131}
21 septembre 1904.
Nous sommes partis hier de Deauville en auto, déjeuné à Vire; arrivés vers sept heures au Mont Saint-Michel. Belle vue lointaine du Mont Saint-Michel quand on sort d’Avranches par la route en lacets: tout à coup, à un tournant, le Mont apparaît, à dix kilomètres, au milieu des sables et au delà d’un paysage verdoyant.
Le matin, au Mont, j’ai été seul deux heures; je me suis promené sur les remparts et dans les ruelles; j’ai causé avec une vieille bonne femme qui sortait d’un pas de tortue, d’un petit jardinet, pour se mettre au soleil. Elle me dit qu’elle avait quatre-vingt-huit ans, qu’elle était veuve, n’avait jamais quitté le Mont, et qu’elle ne pouvait pas réchauffer ses pauvres jambes. Je lui demande si cela la distrait de voir à présent tant de monde.—On a logé dans la saison, chez la seule Mᵐᵉ Poulard aîné, plus de 3.000 automobiles.—Elle ne s’en émerveille point; elle dit avoir vu du monde de tout temps. C’est comme prison que le Mont Saint-Michel a eu pour elle surtout un sens.—«J’ai connu là, dit-elle, des femmes détenues, des enfants; j’ai connu des prisonniers politiques; j’ai connu des républicains, j’ai connu des royalistes; ça a toujours été un peu la même chose. Aujourd’hui c’est les automobilistes qui viennent le plus à ce qu’on dit...» Je lui demande ce qui l’intéresse le plus dans tout cela. Elle dit: «C’est{132} mes jambes qui ne veulent plus me soutenir et qui me font tant souffrir.»
22 septembre 1904.
J’ai vu Combourg. C’est un vieux château fort, en fort bon état et entouré d’un parc magnifique, immense, aéré. Les tours ne sont pas si élégantes que celles de Langeais par exemple; mais elles ont assez bel air. De l’autre côté on a vue sur un étang plus large que la masse du château, et au delà sur le pays alentour qui, sans être beau ni surtout varié, est tout verdoyant et agréable par l’étendue qu’on embrasse. Que de descriptions ai-je lues de Combourg! Il est de bon ton, quand on a fait ce voyage, de prendre la plume du Vicomte lui-même pour décrire la sombre mélancolie du séjour, la tristesse morne de l’étang fangeux, le cri des corneilles, etc., etc. Sans doute un château fort en soi n’est pas gai; mais je n’ai rien vu là de spécialement lugubre, et bien des braves gens durent y vivre sans y contracter la noire humeur et l’indéracinable chagrin de Chateaubriand. Je comprends qu’il y ait pris des idées hautaines; quelqu’un élevé sur ces sommets, à moins qu’il ne soit myope ou borné, ne saurait y contracter une manière de penser terre à terre. Quelles rêveries, de là-haut, pour un jeune homme enclin à méditer, et des pensées d’ambition aussi peut-être, et une certaine impression de la monotonie du monde en face{133} de ce paysage uniforme! L’intérieur est saccagé par la famille, dénuée de goût à l’excès. Un chat en faïence, un peu grotesque, trône sur l’écritoire du grand homme; la grande salle où il frissonna avec Lucie, a été coupée en deux et peinte par des goujats.
1904.
La véritable indépendance de l’esprit n’est pas ce qu’on la croit. On la croit violente et disposée à tout briser; elle est bien plutôt patiente et elle produit peu d’éclats. L’indépendant de nos jours se croit tenu à s’isoler, dans son opinion; pour cela il se crée une opinion originale, qui tranche sur toutes les autres, et aussitôt il en devient l’esclave.
18 janvier 1905.
J’ai remarqué, les rares fois où je me suis trouvé avec des humoristes ou des hommes de théâtre léger, que ces messieurs, qui ne pensent pas qu’on puisse causer sans dire des choses piquantes, ne font jamais que citer des fantaisies d’autrui. Rarement ils ont le mot qui jaillit. J’ai vu plusieurs séances où Alphonse Alais, qui n’était pas là, faisait tous les frais. On connaît par cœur toutes ses farces; on les récite; et ces messieurs, qui tous les connaissent, y semblent{134} prendre un plaisir toujours nouveau. Moi, qu’elles n’amusent point pour la plupart, je me demande si vraiment ces messieurs jamais s’amusent. Des hommes de théâtre ne prennent peut-être de plaisir qu’aux choses qu’ils pensent qu’elles doivent porter sur un public; ils se créent ainsi une sorte de sensibilité à part, extériorisée pour ainsi dire; ils ont pris l’habitude de sentir par un groupe: le public. Cette vision constante du public est une hantise chez eux: ce groupe de gens réunis et ayant payé leur place est bien leur maître; ils en sont les bouffons salariés, mais flatteurs, et ils ne prennent point les libertés du bouffon du roi.
Tristan Bernard a plus de force. Il vit continuellement devant un groupe d’imbéciles affamés de petits mots; il en fabrique à la grosse, et il leur en sert. Mais il est capable de mieux. On dirait qu’il goûte les belles choses. S’il condescendait à ne pas servir, il serait peut-être un maître. Mais on dirait qu’aussitôt que ce damné public vous a adopté, vous êtes à lui. Il le sent si bien que tout l’y ramène. Il dit: «Un tel est fort au poker; je lui disais: un tel, vous êtes plus fort que moi au poker. Mais il y a quelqu’un plus fort que nous.—Qui donc?—C’est le Jeu.» Ce petit dialogue fait bon effet, encore que je croie bien qu’il soit chargé à blanc. Peu importe; là-dessus, Tristan B. s’embarque et dit: «Au théâtre, de même, quelqu’un est plus fort que nous: c’est le public.» Il entend bien dire que le public contient, dans son{135} réservoir d’inconscience, toutes les conditions et toutes les possibilités scéniques; du moins j’imagine qu’il pense ainsi. Mais encore cela est-il feu de poudre, car le génie d’un auteur s’impose à un public hostile, car tout le possible est dans le génie d’un homme, non dans la foule; à peine le certain sens humain de celle-ci sert-il à retenir ou à ramener à de justes proportions les écarts parfois fougueux du génie. Tristan Bernard comme la plupart des petits auteurs ont la conception démocratique de l’œuvre d’art. En définitive, qu’est-ce que le public, en général? Un serviteur, comme ceux.
Sans date (1905?).
Je supplie Dieu de me faire mourir d’un seul coup, afin qu’aux approches de la fin je ne sois pas torturé par des désirs tels que j’en ai eu toute ma vie et qui ne m’ont pas rendu fou, uniquement parce que j’avais l’espoir de les réaliser un jour.
J’ai un de ces désirs, ce soir d’été, dans Paris: c’est de me trouver dans une maison de campagne où l’on possède une belle vue sur des massifs d’églantiers en fleurs, d’abord, et puis sur des pelouses bien larges, bien longues, où une allée serpente et coupe un ruisseau, et que tachent en deux ou trois endroits de gros bouquets de peupliers, de saules et d’érables. Qu’au delà, un petit coteau aille se perdre le plus loin{136} possible... Mais ce que je désirerais surtout dans ce décor, c’est que les voix que l’on entend, dans le soir tombant, au pied de la maison, à l’intérieur, ou bien de l’autre côté d’un mur, me fassent elles aussi l’effet d’être perdues dans l’immense espace du ciel calme et dans la solitude des champs. Le charme vraiment exquis, c’est le départ tranquille ou bien la fuite éperdue des choses vers un lointain indéterminé.
1905.
La religion, c’est, sous une forme grossière, l’affirmation de l’esprit. Quand je pense, tous les jours, qu’il y a un monde spirituel, une vie intérieure, au prix desquels la vie physique et tous ses avantages et progrès matériels ne sont rien, je me range du côté des esprits religieux.
1905.
Il y a quelque chose d’indécent à parler politique de nos jours: on se rue sur ce sujet avec tant de frénésie qu’on dirait qu’on satisfait ses instincts les plus bas.
Il ne faut pas laisser causer politique, à dîner, ou dans un salon, quand les femmes s’en mêlent. On comprend, à les voir, le rôle qu’elles jouent dans les Révolutions.{137}
1905.
J’ai dit, l’autre soir, chez Victor Margueritte, qu’un de mes sujets d’aversion pour nos démocrates actuels est qu’ils ont entrepris d’anéantir le rôle de l’Honneur dans nos mœurs, dans notre moralité, dans notre intelligence. Il ne dit pas non; il dit: «Je vous assure qu’il y a grand mouvement dans les esprits, non seulement en France...
—Ah, si ce n’est pas qu’en France, le malheur est moins grand, puisque nous nous affaiblirons en chœur; mais cependant...»
Leur recours est de toujours s’appuyer sur un mouvement concomitant dans les différents États. Mais il n’apparaît pas si clairement. Quand on leur parle du réveil des nationalités, ils vous répondent par le progrès du socialisme; et on dirait que le socialisme est un terme qui est compris exactement dans le même sens à Berlin, à Vienne, à Rome et à Paris. En attendant, Kautzky renie complètement Jaurès en son apologie de la délation. L’entente n’est pas nette.
La vérité est qu’il y a deux mondes, l’un ancien, formé par le catholicisme et aussi par la culture des lettres et de l’histoire, pour lequel la conception du monde est éclairée par une idée morale. L’autre est constitué par un peuple qui, d’abord et avant tout, veut vivre, mais à qui on a promis la jouissance{138} matérielle, et par une portion de société adonnée à la jouissance immédiate de la vie.
L’un semble vieux; l’autre jeune. L’un est moins avide de vivre, parce qu’il a vécu, par ses pères, par ses souvenirs, par sa culture, et parce que peut-être aussi, pour lui, la vie n’est-elle pas qu’un assouvissement de passions, mais bien plutôt une contrainte, la vision constante d’un sacrifice nécessaire. L’autre ignore la contrainte, et la jouissance matérielle a l’attrait de l’orgie. Aucune idée ne le bride. Des trois freins qui ont donné sa forme, sa conscience, son âme et sa viabilité même au vieux monde, Dieu est rayé, la patrie est rayée, la famille est rayée: l’individu reste seul pourvu de ses instincts, auxquels il faut joindre la haine qu’on lui prêche chaque jour contre le monde adverse présenté comme l’ennemi.
Le rôle de ceux qui ont participé par leur naissance et leur éducation aux avantages qu’offrait le vieux monde serait 1º de déterminer nettement ce qu’ils considèrent comme des avantages essentiels à la vie—et, par exemple, non pas ce qui contribue à rendre la vie plus aisée ou plus voluptueuse, mais ce qui contribue à la rendre durable, à la perpétuer dans l’avenir; et 2º de les enseigner au monde nouveau. Au lieu de cela, ceux qui se mêlent au monde nouveau et l’embrassent avec débordement d’amour, ont tout l’aveuglement des amoureux: ils admirent ce jeune inexpérimenté tel qu’il est, le complimentent de son ignorance, l’encouragent en ses témérités ou{139} ses inconséquences. Et par exemple, un monde ne saurait vivre sans une certaine contrainte: ils brisent toutes celles qui le pourraient retenir. Si Dieu n’est plus possible—ce qui n’est pas démontré—il fallait garder comme un fétiche le culte de la patrie qui enchante l’héroïsme, et qui, une fois développé dans le cœur, met l’homme en l’état de désintéressement, en une certaine aptitude à se sacrifier en faveur de quelque chose qu’il ne voit pas, qu’il ne touche pas du doigt. L’homme préparé à se sacrifier pour son pays, se sacrifiera pour le corps auquel il appartient, pour sa famille, pour l’honneur de son nom. L’homme qui ignore l’état de désintéressement ne fera qu’un lâche. Sa peau est le seul bien; il n’est propre à défendre qu’elle.
Ils nient le patriotisme, comme trop étroit, et ils vous disent: le patriotisme national sera remplacé par le patriotisme européen. Oui, et peu à peu, cette évolution se produira, mais à la condition que le patriotisme national ne mente pas, ne disparaisse pas du cœur des nationaux. Le jour d’un péril oriental ou américain, vous n’improviserez pas le désir de défendre l’Europe à des hommes qui auront renoncé depuis beau temps à défendre leur sol national. Le patriotisme national est bien le développement du patriotisme régional ou provincial, mais parce que le patriotisme régional ou provincial n’a jamais cessé d’être vivace. (Ex. le patriotisme français du Lorrain.){140}
Le patriotisme—que l’on appuie non pas sur un concept moral gratuit, mais sur une nécessité d’ordre physique, vital—me semble devoir être le pivot, et le seul possible, de la vie morale des hommes.
C’est l’esprit de corps le plus étendu que l’on puisse raisonnablement imaginer; et sans esprit de corps, pas d’honneur.
Quinton admirait l’autre soir les députés du «bloc» d’être capables de voter contre leur conscience pour sauver leur parti. Je crois cette opinion très dangereuse, surtout aujourd’hui que tout se passe publiquement. Comme moyen de gouvernement, c’est admissible, à la condition que cela demeure occulte—encore trouvé-je ceci odieux—mais c’est aujourd’hui démoraliser les individus. L’électeur ne discerne pas une morale de gouvernement et une morale individuelle: l’exemple donné en haut lieu est servilement imité.
Je m’aperçois que je passe une partie de ma vie en compagnie de gens devant lesquels je n’oserais pas parler d’honneur, parce qu’ils me traiteraient de pauvre garçon. Ils ne sentent point cela qui bouillonne en moi, qui est ma suprême ressource et la source même de mon activité.—Car pourquoi donc est-ce{141} que je fais de la littérature?—Qu’aiment-ils? Vivre. Mais ils vivraient partout; ils ne défendraient point leur sol; ils ne se sentent point faire partie d’un grand concert qui joue une certaine musique et point telle autre. Ils se feraient à toutes les musiques. Il n’y a rien pour quoi ils se renonceraient eux-mêmes. Or, c’est cela qui me semble le faîte de la volupté: souffrir pour quelque chose qui est bien moi-même, mais agrandi ou magnifié: honneur, œuvre, patrie.
18 mars 1905.
J’ai appris hier la mort d’Hugues Rebell. Il a été mon plus intime ami, quoiqu’il ne fût point parfaitement intime avec moi, de grandes différences de tempérament existant entre nous; mais dans un temps où je ne fréquentais guère d’hommes, il a été mon compagnon le plus intelligent, et le meilleur exemple pour moi de l’homme de lettres. Je n’en ai point rencontré d’autres qui le valussent comme dévouement à la chose littéraire; aucun homme ne m’a paru aussi épris de la pensée humaine, aussi affamé de culture, ni aussi exclusivement adonné à l’ivresse de l’esprit. Il y joignait la luxure, il est vrai. Il n’a vécu que pour l’esprit et la luxure. Il est mort de l’un et de l’autre.
Les circonstances de sa mort rappellent les aventures un peu barbares, un peu désobligeantes, et d’une{142} passion assez particulière, qu’il aimait et qu’il inventait. Il est mort victime de son attachement à ses livres et du besoin de vivre mêlé à un corps de femme. Il s’était fait ruiner par une petite grue; il était tombé dans une extrême misère; il avait tout vendu sauf ses livres; il empruntait même, mais ne vendait pas ses livres. Cousu de dettes criardes, obligé de travailler presque jour et nuit—ce qu’il a toujours fait, d’ailleurs,—pour gagner quelque argent, et très malade, malade à mourir, par-dessus le marché, il fut obligé de se cacher pour se soustraire aux créanciers. Une femme, bonne et maîtresse, lui procura un Juif qui lui avança sur sa bibliothèque de quoi quitter son appartement et disparaître. Il se réfugia près de la place des Vosges, chez cette femme. Cinq voitures de livres furent déballées dans la chambre; et le Juif, ami de la femme, venait, paraît-il, surveiller ses gages. Le Juif fournit un nouveau médecin. De quoi était atteint Rebell? je ne l’ai jamais su. Le médecin le piquait à la morphine depuis deux mois, et voulait le faire entrer à l’hôpital. L’hôpital était la terreur du malheureux: c’était la perte de ses livres et de la compagnie d’une femme. Sa situation était lamentable. Son frère lui offrit, paraît-il, de le prendre chez lui à la campagne. Il dit qu’il était bien là. Il mangeait à peine, la femme n’avait pas de quoi se mettre sous la dent; des amis lui faisaient quelque charité. Ils vivaient là, ou mouraient de faim, autour de 45.000 francs de livres, valeur déclarée par Rebell{143} même à la concierge, à tous. Un jour, soudain, son ventre enfla; on courut au médecin; il ordonna le transport immédiat à l’Hôtel-Dieu. Et la concierge qui me fait ce récit, me dit qu’il ne serait pas mort si on l’avait laissé chez lui, avec ses livres. Quand on lui a parlé d’hôpital, c’était un homme mort. Il a recommandé à la femme, en se laissant emporter, de ne pas surtout toucher aux livres, qu’on ne balaie pas. On l’emmène, sans un sou; on le dépose dans la salle commune. D’horreur autant que de maladie, il est mort dans la nuit même.
Sans date. Grand mariage à Saint-Pierre-de-Chaillot
(Mˡˡᵉ V.).
J’arrive à une heure moins le quart (le mariage est à midi précis) au milieu du discours d’un archevêque que j’aperçois là-bas, dans le chœur, tout mitré et qui prononce de belles phrases, un délayage de lieux communs sur la patrie, sur l’Académie française, sur les périodes agitées, sur la résistance nécessaire, sur «la guerre déclarée aux vérités les plus simples», etc. Que ce langage ecclésiastique est plat et pauvre! comme il est servile vis-à-vis de toute dorure, de toute richesse! que c’est bien une parole du «siècle», la parole d’une douairière affligée par la tristesse des temps! et que c’est peu la parole du disciple du Christ! Jamais je n’ai entendu à l’Église l’accent de l’Evangile.
Et la cohue élégante arrive. Une jeune femme,{144} devant moi, sert de point de mire; de beaux messieurs, la bouche en cœur, se précipitent; on se fait des sourires de loin, on s’approche, on se serre la main, on papote, on rit, on se fait des confidences à l’oreille, puis voilà que sonne l’élévation, et tout ce monde qui est depuis quelque temps bon catholique, se courbe et s’aplatit devant le mystère divin; on sonne de nouveau, ils se relèvent et le bavardage a repris de plus belle. Quel bavardage! Je surprends des conversations politiques, des vues générales sur le suffrage universel, sur les trucs et moyens propres à changer le sens des suffrages: pensez donc que c’est la religion de ces gens-là qui est compromise, leurs beaux chapeaux qui deviennent suspects, leurs réunions aux pieds d’un évêque tout en or, à quoi l’on attente! Et quels gens que tout cela! le regard mort, cet œil méprisant quand il s’abaisse sur quelqu’un qu’ils ne connaissent pas: ce sont des gens qui n’ont pas de frères, ces chrétiens ne connaissent que l’orgueil de caste: on n’est pas de leur monde: on n’est pas digne de vivre. Ces femmes vous tiennent pour quantité négligeable: je me trouve au milieu d’un groupe de femmes; elles ne me connaissent pas: elles se parlent sous mon nez, elles me pressent, elles me piétinent, elles m’éliminent; je me trouve reculé sans l’avoir voulu; elles n’ont pas levé sur moi les yeux. Et des mots de parade, des affectations, des protestations amicales qui ne sont pas d’ailleurs toujours bien accueillies. J’ai vu une femme en couvrir une autre de{145} mots aimables et d’excuses pour n’avoir pas encore été la féliciter (de quoi? je ne sais). Et l’autre n’a pas répondu; et la flatteuse à qui l’on ne pardonne pas son retard, a dû se faufiler, s’en aller, faire du moins des tentatives pour ne pas demeurer sous l’œil et le souffle glacé de la rancunière, et elle n’a pas pu s’en aller; elle a failli défoncer deux autres femmes, elle a été retenue là, dans une pâte compacte, attrapée par celles qu’elle vient de bousculer, humiliée de sa tentative de fuite, et tout de même sous l’œil de la première.
Sans date.
Pense-t-on à se demander quels rapports peuvent bien exister entre les saints du calendrier et les noms généralement en usage? Et pourquoi s’obstine-t-on à consacrer une portion si notable de nos almanachs à des saints dont le nom n’est jamais seulement une fois prononcé par nous au courant de la vie?
Il suffit de parcourir la liste: qui est-ce qui s’appelle Athanase, Mamert, Servais, Pacôme, Ildebert, Lié, Avit, Aubierge, Gualbert, Abdon, Mammès, Maurille, Andoche, Probe, Frumence, Philogone?
Sans date.
Faguet croit que le Français naît avec un instinct de guerre civile; tout jeune Français est élevé dans{146} l’idée qu’il doit détester une catégorie d’individus. «Il est de corps actif et d’esprit paresseux.»—«Il sent le besoin d’agir et il n’aime pas à se donner beaucoup de peine pour trouver un motif d’agir.»
Les philosophes du XVIIIᵉ siècle ont cru que les religions étaient la cause des guerres dites de religion; mais, les religions abattues, on s’est battu pour d’autres idées. «Le Français est irréligieux ou peu religieux, d’abord en raison d’une de ses qualités, et c’est à savoir parce qu’il a l’esprit clair et le goût de la clarté.»
Faguet rappelle le mot de Hegel: «Il faut comprendre l’inintelligible. Eh, oui, il faut le comprendre comme inintelligible.» Les Français ont fait un principe de ceci: que ce qui est vrai, c’est ce qui est clair. C’est l’enseignement cartésien; mais il n’est pas rigoureusement exact. «C’est vraiment un devoir pour l’homme cultivé, dit Faguet, de chercher le point où précisément l’évidence cesse, et le point où la probabilité cesse et où l’hypothèse commence à être non pas rationnelle, mais tout imaginative.» «Le Français fait du bon sens un cas énorme; le bon sens est précisément cette demi-clarté dont se contente le Français en l’appelant évidence.»—«Le trop grand goût de clarté, c’est ce qu’on a appelé le «simplisme». Ce qui n’est pas simple n’est pas vrai: axiome français. Or, rien n’est simple excepté le superficiel. Les Français ont une tendance à repousser les métaphysiques et les religions, qui n’est qu’une{147} forme de leur horreur de creuser les questions.»
Un autre caractère du Français, qui s’oppose à ce qu’il soit religieux, c’est sa vanité. Tout Français est vain. La vanité est individuelle; l’orgueil est collectif. L’orgueil peut s’accommoder de la religion, car on s’enorgueillit d’appartenir à une glorieuse collectivité, la vanité répugne à être enrégimentée.
Le Français est, de plus, anti-traditionaliste. La tradition, c’est les vieilleries. Il méprise les vieilleries; il ne peut pas être respectueux.
Sans date.
Il y a des noms qui me ravissent. Parmi ceux de l’ancienne noblesse française, combien ont une euphonie délicieuse! Je vois une femme un peu grasse, avec des bras jolis, des fossettes, une gorge admirable et quelles hanches, quand je lis, sans aucun détail qui m’éclaire sur ce qu’elle a pu être: «la comtesse de Polastron».
Sans date.
Taine me fait sentir admirablement que le défaut si sensible pour nous dans Racine, son humanité transformée ou déformée, si différente par exemple de celle d’Euripide, c’est une humanité sujette du Roi, monarchisée au suprême degré.
Le sentiment des convenances aristocratiques y{148} remplace partout le sentiment personnel et humain. Il subsiste dans le monde aristocratique d’aujourd’hui quelque chose de ces conventions si bien implantées, qu’elles forment une seconde nature qui étouffe la nature humaine et rend par exemple faciles l’accomplissement de grands sacrifices, tel celui de la vie (Iphigénie de Racine si prompte au sacrifice,—celle d’Euripide si tendrement murmurante—sentiments du devoir dans certaine haute société, etc.).
Sans date.
On ne s’aperçoit pas que la liberté des mœurs que l’on s’efforce d’atteindre, et, dit-on, en faveur de la femme, aura infailliblement pour conséquence de placer la femme dans la condition d’un animal domestique, dont on use, qu’on échange sans autre considération que l’avantage qu’on en retire. Le prestige, la royauté de la femme, c’est le christianisme qui les a faits, ils disparaîtront avec lui.
Sans date.
Quelle est donc la vertu singulière de l’angoisse chrétienne, pour qu’elle communique à tous les grands esprits qui en sont touchés je ne sais quelle beauté et quelle magnanimité d’âme, ou quelle passion enfin, que n’ont pas tout de même un Socrate, un Montaigne, un Gœthe?{149}
13 juillet 1905.
Seul, au bord de la mer, dix heures du matin, par un temps doux, voilé. Adossé à une falaise de sable. Toujours insatisfait, toujours triste, toujours inquiet, me voilà revenu encore ici. Dans un moment de paix et de silence de tous les bruits chaotiques de la vie, le grand murmure de la mer semble me dire que jamais, le silence complet, je ne le goûterai. Il y a un bruit clair et déchirant, proche de moi, à deux cents mètres: c’est l’image de toutes les choses qui m’ennuient, m’incommodent, m’agacent dans la vie quotidienne. Et de beaucoup plus loin vient un sourd et large grondement, pareil à des orages ou bien au grave ronflement d’une conque marine: cela semble monotone; et en l’écoutant bien, cela est une mélopée sombre et pathétique, une plainte d’abord sur une même note, puis qui s’enfle, et puis qui s’exaspère comme la sirène, mais sans s’éloigner sensiblement de la note initiale. Ceci, c’est moi, c’est mon âme qui sans les mille tracasseries de la vie serait en proie à une constante et plus cruelle douleur...
Juillet 1905.
L’ignorance des littératures anciennes sera d’un certain secours pour les penseurs de nos générations nouvelles: ils croiront à tout propos découvrir le{150} monde; personne ne sera là pour leur faire remarquer que le monde est depuis beau temps découvert; et l’orgueil de l’invention les soutiendra et les ravira.
Même date.
Il y a quelque chose d’irritant pour un vaniteux, mais de consolant pour un homme doué du véritable orgueil, à trouver sans cesse, en lisant les auteurs anciens, ce qu’il avait cru découvrir lui-même. C’est une déception pour le premier; pour le second c’est une confirmation précieuse de la justesse de sa pensée.
Été 1905.
«L’Égoïste.» N’espérez pas l’atteindre par un acte de générosité. Vous avez cru lui faire honte, mais il est incapable de comprendre que vous puissiez agir par un motif autre que celui qui le fait agir lui-même. Et ce que vous avez fait, il croit que c’est parce que tel a été votre bon plaisir.
Nom aperçu hier en passant en auto en Normandie: Lebigre.{151}
Acheter l’édition des Pensées de Pascal, de Brunschvieg (Hachette 1897, un vol. in-18). Il y a une grande édition du même en trois volumes. (Collection des grands Écrivains).
Été 1905.
Il faut trouver le moyen de cesser, en littérature, de peindre la faiblesse ou la bassesse de l’homme, ou, du moins, de la peindre sans faire sentir que l’homme peut être et est parfois aussi grand qu’il est faible.
L’ironie, comme moyen littéraire, est un moyen moral, car elle laisse entrevoir que l’auteur se moque des faiblesses que comporte la comédie humaine,—tandis que le système de l’impersonnalité à outrance n’indique rien et ne laisse pas entendre au lecteur que l’Homme, sujet de la comédie, est aussi capable de prendre sa revanche.
30 août, 5 h. du soir, au dolmen.
Je sens si bien que rien au monde ne me donnera jamais une plus profonde émotion, un plus vrai ravissement, que la vue de cette campagne de Courance vue du dolmen, par ces après-midi chaudes de Touraine.
Le dimanche à la campagne est complètement désert, il n’y a pas un bruit, pas un mouvement.{152} J’entends un petit grésillement dans le buisson derrière moi, un coq qui chante très loin. Tout est suspendu dans une paix radieuse, qui n’a jamais été troublée. Je pense que les guerres, les révolutions ont pu passer sans qu’en cet endroit rien ait été violemment agité. Des hommes sont partis et ne sont pas revenus, mais jamais le canon n’a retenti sur ce domaine. Il n’y a pas ici d’arbres tordus par les vents, aucun signe des ravages de la nature. Les peupliers expriment la paix qui monte vers le ciel, en ligne droite, comme une fumée dans l’air immobile.
1906.
Type d’une jeune fille de nos jours, vue en tramway. Vraiment jolie figure régulière quant aux traits; sourcils admirables, longs, presque droits, abaissés presque brusquement vers les tempes, et très rapprochés de l’œil, ce qui donne à celui-ci un air de gravité, de profondeur. Des yeux bleus d’acier, assez durs, mais qui prennent, surtout en parlant à un homme, une expression de tendresse langoureuse, coquette, et qu’on sent une attitude habituelle, un mensonge de coquetterie passé à l’état d’habitude, devenu un charme permanent. Ces yeux sont grands, bien dessinés, beaux. Le nez est parfait, aquilin, fin, sévère, dominateur, de ces nez de femmes qui ne sont plus servantes, mais qui règnent. La bouche{153} fermée est digne de l’antique dont elle a presque la divine moue, les coins abaissés, et le petit arc d’Eros complètement dessiné. Ouverte, elle contient toute la canaillerie moderne. Elle s’ouvre trop; elle s’ouvre sans retenue, sans pudeur aucune; on voit toutes les dents, qui sont de coquines de dents peu régulières, libérées de toute discipline, mais non sans agrément; on voit la langue. Elle promène cette petite langue sur ses lèvres, en bas, en haut, comme un animal, c’est extrêmement impudique et séduisant. La veulerie, l’abandon, l’indifférence, le goût du plaisir bestial, la gourmandise, l’amour facile, le libre bagout, quelque chose d’un peu gavroche et même voyou, tout ce caractère de notre temps est dans cette bouche, voluptueuse et vulgaire. Les cheveux sont ondulés largement, levés largement et très haut sous un chapeau très grand, mais qui n’a pas de largeur parce qu’il est incliné à quarante-cinq degrés et s’élance audacieusement, lui aussi, librement. Il n’y a plus, chez les jeunes filles, ni retenue, ni contrainte, à peine de tenue; elles ne se distinguent pas des femmes. Leur attrait est singulièrement vif.
Avril 1906.
Il y a quelque chose de si radieux dans la splendeur des journées d’ici, sous le ciel absolument pur et sous le soleil ardent, quelque chose de si insolite pour nous,{154} qu’aucun mot ne me vient pour l’exprimer. Cela a pour moi le charme des choses inconcevables comme l’amour, la beauté.
Même date.
Rêverie au Mont Alban. Décrire, autant qu’il se peut faire, cette merveille inconnue, cette succession ininterrompue de tableaux sublimes à chaque pas que l’on fait sur un sol embaumé de thym et de l’odeur des pins, et le plus caressant qui soit pour un œil de peintre ou de poète.
Délices particulières qui montent de cette belle ville couchée comme un chien, comme l’enfant dans le sein maternel, en rond, autour de ce noir noyau du château où est le cimetière qui semble tout de marbre blanc. Le murmure continu qui monte du côté de Nice, tandis que du côté de Villefranche c’est le silence complet. Plaisir de dominer la ville, tout en étant si près d’elle, et la ville la plus légère, ville de plaisir, ville aussi de tous les mondes, de toutes les races.
1906.
Faire entendre peut-être, en une préface, que Madame de Pons n’était pas en réalité ce que son amant imaginait et croyait qu’elle était, et qu’il en est peut-être revenu plus tard; mais que cela ne soit pas{155} indiqué dans le récit, parce qu’il aime tout le temps qu’il écrit, et qu’il est aveuglé tout le temps qu’il aime.
Elle lui serait apparue, un jour, telle qu’il pensait qu’il la verrait certainement le jour où il cesserait de l’aimer.
Il dit toujours qu’elle est, moralement, intellectuellement, l’être fait pour le ravir tout entier. Il aurait honte, dit-il quelque part, si à son âge, avec sa culture et son âme, il aimait une femme d’un tel amour, qui ne serait pas digne d’être le meilleur et le plus élevé de ses amis. Il la croit telle; mais il se pourrait qu’elle ne le soit pas. Le faire entendre comme possible[P].
6 avril 1907.
Me voilà de retour à mon cher Mont Alban. Je m’assois au milieu des thyms et des euphorbes par un temps tiède, un ciel à demi voilé. Entre les pins, le cap Saint-Jean paraît avec sa tour; un yacht le contourne; le cap d’Ail semble pointer en se jouant au milieu d’une flottille de canots à voile. Derrière moi monte la rumeur de Nice, autour de moi le silence que pique un cri d’oiseau, qu’enchante un son de cloches lointaines. Un petit sentier de terre de Sienne et de{156} rocaille, semé de crottes de chèvres. Point de mouvement que celui de mon chien qui attrape au vol les moucherons. La mer est comme une tenture de soie grisâtre et lilas: il n’y a pas d’horizon. Dans le ciel, des suavités d’Angelico, isolées, oubliées là par mégarde par le peintre, tout le reste étant de grisaille. La paix des choses, la sérénité des lignes, la grâce harmonieuse de couleurs fondues a une beauté dont la grandeur s’impose, et dont la discrète majesté confond tout lyrisme.
Même date.
Il ne faut qu’un hasard pour mettre un esprit sur la veine féconde, et à peine y est-il engagé qu’il accumule les découvertes, qu’elles soient du domaine physique ou du moral; et il sera un homme de génie. Mais peut-être que faute de la rencontre fortuite qui l’a amené au débouché de la veine, il demeurait, avec tout son génie, sa vie entière stérile?...
Même date.
Cette vue, qu’on a de la terrasse de Brimborion, et dont je ne me lasserai jamais de chanter la beauté! Un peu avant six heures, le soleil baisse sur les jolies montagnes et mire dans la baie sa face démesurément allongée. Dans la grande vallée se trouve la brèche{157} de Saint-Jeannet, il flotte une nuée de poudre d’or vert. La partie de Nice que l’on voit est sous un nuage de fumées à peine rosées; et du port, la cheminée d’un vapeur envoie vers le ciel une colonne de fumée toute droite qui donne une impression de calme.
Août 1908.
Une curieuse révélation chez deux êtres très cultivés, homme et femme, qui causent entre eux de sujets élevés: c’est à une éclatante contradiction dans les idées de la femme, c’est-à-dire à une faiblesse, que l’homme a senti qu’il l’aimait, qu’il a eu le plus envie de baiser la bouche qui venait d’émettre une idée absurde. Elle, au contraire, avouerait qu’elle l’a le plus désiré quand il a fourni les plus fortes preuves de logique.
31 mai 1909.
Chez P. le soir. En descendant de voiture, on voit, au second, les fenêtres illuminées, et on entend un murmure de voix au milieu desquelles se détache l’inlassable discours, scandé, martelé, aux termes aiguisés, apointuchés, qu’assène sans relâche X. aux personnes accoudées à ses côtés.
La duchesse d’Y. à qui on me présente, me fait{158} l’éloge de mes livres: je suis le dernier qui écrive en français.—«Non, non, nous sommes quelques-uns...»—Non, non, elle y tient, personne n’écrit comme moi... et ainsi de suite. Et elle me dit, elle aussi: «On ne sait pas comment on est attaché à vos livres, car enfin, il ne s’y passe rien.» Les drames moraux ne comptent plus en effet; l’amour même, s’il n’est accompagné de son geste, passe pour peu de chose. C’est moi qui lui fais observer ceci, et elle me dit: «En effet, on n’a plus le temps d’avoir un sentiment; il faudrait des loisirs. Entre deux courses, entre deux thés, on fait l’amour; ça n’a pas d’autre conséquence.» Elle accompagne cela d’un geste esquissé qui signifie qu’on se laisse trousser, au coin d’un meuble, et qu’on n’y pense ni avant, ni après, à peine pendant.
Sans date.
Le bain à Trouville.
Les femmes portent cette année, au bain, des jerseys collants à la taille, une ceinture et une sorte de jupe assez longue, qui est d’étoffe fine et qui sait appliquer si bien sur les formes, quand elle est mouillée, qu’on peut supposer qu’elle dispense de porter un pantalon. Des femmes plus hardies sont vêtues du maillot noir, fortement décolleté, terminé à mi-cuisse, découvrant complètement les bras et l’aisselle,{159}—le maillot d’homme.—Comme celles qui osent ces costumes de bain sont dignes de les porter, leur exhibition dans l’eau est de l’effet le plus élégant, le plus gracieux, et il faut dire nettement: le plus beau.
Ces torses de femmes, émergeant de la mer, noirs et luisants comme des otaries, et révélant sans aucune pudeur des seins superbes, dressés, provocants de la pointe: ces beaux bras, ces dos, ces ventres, et, au sortir de l’eau, ces fines hanches mouvantes et ces jambes qui marchent si bien, avec une si noble lenteur, dans l’eau qui les entrave; et ces mouvements charmants de la natation, et la montée à l’échelle du canot, le geste de s’y asseoir, l’attitude de ces femmes, vraiment nues, assises le torse droit, dans une attitude de déesse, en cette barque, en face du vieux matelot qui pagaye doucement; et leur lente retombée dans la mer; c’est un des plus jolis spectacles que notre vie, si chiche de beauté plastique, puisse offrir.
Août 1909.
Lorsque je songe à mon heure dernière, l’angoisse la plus pénible que j’éprouve c’est de penser à la faculté d’émotion qui va périr avec moi, j’ai la sensation que c’est une richesse, un trésor considérable qui va être jeté à la mer.{160}
8 janvier 1912.
Je suis un lyrique détourné de sa voie. Je ne fais que me chanter moi-même, d’une façon timide, sous le couvert de figures auxquelles je donne des noms. Mes romans sont mes haines, mes mépris, mes aspirations, mes dépits et mes rages.
Janvier 1912.
L’Art pour l’art.
Conception qui semble fausse, parce qu’on entend généralement par là que l’art né de l’art même n’a pour fin que lui-même. Mais l’art ne naît pas de l’art. L’art naît de collaboration amoureuse de notre inconscience, d’une part, et d’autre part de la vie.
L’art produit par un homme uniquement préoccupé d’œuvres d’art, est stérile. L’art viable ne vient pas du temple; il vient de la rue et s’achemine vers le temple.
Ce n’est pas sur le but de l’art que l’on se trompe en prononçant la formule l’art pour l’art, c’est sur l’origine de l’art. L’art n’a pas d’autre fin que l’art, mais il ne provient pas que de l’art.
L’émotion qui vient de l’admiration de l’œuvre d’art a quelque chose qui brûle et consume les organes de la fécondation artistique chez celui qui l’éprouve. Elle le leurre. Elle le pousse à faire œuvre d’art, mais elle le bute à l’imitation de l’œuvre d’art.{161} L’œuvre d’art originale a une origine plus modeste; elle est d’ordinaire plébéienne, si l’on peut dire: ses générateurs ne sont pas œuvre d’art.
1912.
Les compliments du monde sont aussi prompts, aussi vifs que les dénigrements.
1912.
«De balustres plus hauts.» Titre possible d’un roman de l’auteur de «l’Enfant à la Balustrade».
Conclure à un stoïcisme qui admet et pratique le sourire—à mon sens le degré le plus élevé de l’héroïsme. Tableau de toutes les injustices possibles; beauté de la raison bafouée, exaltation des médiocrités, triomphes des médiocres—et conclusion sereine dans la contemplation intérieure, comportant une sorte de joie qu’une conception de beauté s’élève de ce bourbier, sourire ému à la fleur qui naît de la fange.
1912.
Celui qui «s’exprime bien», c’est celui qui fait un soliloque, c’est celui qui, s’adressant dans la conversation à autrui, ne tient pas compte d’autrui, mais{162} de soi-même. Celui qui tient compte d’autrui, ne s’exprime plus déjà bien; il s’exprime et il se déprime à l’usage d’autrui; la force qu’il emploie à définir autrui, puis à dire pour autrui ce qui peut être entendu par autrui, il l’emploie à ses propres dépens, il se fatigue, et de plus il se trahit en usant d’une langue qui n’est pas tout à fait la sienne.
1913.
Les femmes qui sont douées d’imagination, on n’a pas en somme avec elles d’autre plaisir que celui de la conversation; car elles n’emploient leur imagination qu’à concevoir d’autres amours, et vous en souffrez si vous êtes leur amant. Il ne faut pas être leur amant, il faut être celui qu’elles peuvent rêver d’avoir pour amant.
Sans date.
On est en train d’apprécier un monsieur, et, d’ailleurs, avec bienveillance. Quelqu’un conclut:
—Oui, oui; mais c’est un homme qui ne casse rien.
Ça y est. L’homme est exécuté, car, pour être un citoyen qui compte, il faut casser quelque chose. L’état d’esprit qui exige ce sacrifice, est aujourd’hui généralisé.
S’il s’applique à un homme qu’on dit, par exemple,{163} intelligent, le «il ne casse rien» signifiera que le pauvre garçon n’a rien d’extraordinaire.
Or il faut être extraordinaire.
Quelle singulière conception des choses! Nous venons de traverser un siècle scientifique, lequel nous a appris qu’il n’y a que des phénomènes naturels. La multitude infinie des sphères ne se maintient probablement qu’en vertu d’un parfait équilibre. Si l’une d’elles seulement se mettait à faire des excentricités, il n’y aurait, je le crois, plus guère de beaux jours pour les amateurs d’extraordinaire.
Est-ce que, par hasard, ce qu’on appelait autrefois le Sens commun—et qui est tout simplement l’auteur de la Sagesse des Nations—ne pourrait pas être appelé en consultation? Pas prétentieux pour deux sous, il avait, lui, le goût de la bâtisse, ce qui nous serait bien utile: on a beaucoup cassé...
Sans date.
Le véritable esprit du classicisme, je le vois exprimé par cette phrase de Joubert: «Ce n’est pas ma phrase que je polis, mais mon idée.»
18 octobre 1921.
Quel torrent nous entraîne! Assis dans un des endroits les plus beaux et les plus aimés—au{164} Jardin du Luxembourg par une après-midi radieuse et chaude—je savoure ces instants heureux, je pense agréablement au passé que j’ai vécu là; j’ai conscience de jouir de quelques minutes privilégiées... et je n’en ai pas consacré dix à cette méditation qui est conforme à mes goûts, que je bâille!... Quelque chose m’ordonne d’agir. Nul temps n’est donc fait pour rêver? Ma nature m’ordonne secrètement de me lever et de courir à ces actions qui, même futiles et même tout à fait vaines, du moins ont cela pour elles qu’elles nous arrachent à la conscience de vivre. On vit; on ne doit pas se regarder vivre.
Juillet 1923.
Prendre un ton simple, «se mettre à la portée», c’est très bien, et l’on peut dire d’excellentes choses sur ce mode; mais c’est une dangereuse habitude de l’esprit; il risque, en l’adoptant, que le parti exprimé trop simplement ne gagne la pensée; gardons-nous, sous le prétexte de nous faire comprendre des simples, de n’avoir plus que des idées puériles.
Même date.
En un sens la littérature est bien plus que la vie, puisque chez certains—comme moi—le fait d’écrire{165} me fait passer à un état d’activité, d’intelligence, de passion même, qu’ils n’atteignent pas dans la vie.
C’est à cause de cela que la littérature est si frappante pour ceux-là mêmes qui vivent le plus. Ils ne s’élèvent pas à ce degré où un homme assis à sa table et dénué de passions est arrivé par un enchantement.{168}{167}{166}
⬛
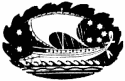
NOTES:
[A] «C’est ainsi que j’ai appris, dès ma prime jeunesse, que les écervelés, seuls, imaginent pouvoir soustraire même un petit enfant à l’influence des événements publics; et nul, depuis lors, ne m’a paru plus niais qu’un monsieur ou une dame qui, en buvant une tasse de thé ou un verre de porto, se proclament anarchistes.» (La Touraine, p. 49.)
[B] «Je ne crois pas mauvais que la proportion soit rompue en faveur de ceux qui aperçoivent la vie conformément à une idée préétablie. Ceux qui jugent impitoyablement chaque objet, chaque individu, chaque action, ont leur utilité grande, mais à quelle anarchie le monde serait-il livré si la nature prévoyante n’avait créé la plupart des hommes ingénus, aveugles et crédules!» (La Touraine, p. 71.)
[C] Il va de soi que je ne vise pas ici la veine de la comédie, dont le Bel Avenir par exemple offre une si alerte réussite, mais celle de Les Leçons d’Amour dans un parc, la veine d’un XVIIIᵉ siècle qui a passé par Anatole France. Il n’y aurait rien à dire contre France si seulement nos écrivains consentaient à l’oublier, à nous laisser à nous, lecteurs, le soin de nous souvenir de lui.
[D] Ces quelques pages ne prétendent en aucune façon à étudier en son détail l’œuvre de Boylesve—qui au reste, du vivant de l’auteur et au lendemain de sa mort, a donné lieu à nombre d’excellents articles: parmi eux il convient d’isoler celui de Jean-Louis Vaudoyer: Près de René Boylesve (Hommage à Boylesve—Les Nouvelles Littéraires, 23 janvier 1926): en des dimensions que le cadre mesurait, avec ce bonheur d’expression qui est celui de J.-L. V., je ne sais rien sur Boylesve de plus finement, de plus tendrement exact.—Je tiens toutefois à marquer ici ma conviction qu’avec le recul cette œuvre apparaîtra la plus importante et la plus solide qu’ait produite le roman français entre Flaubert et Proust. J’ai parlé ailleurs de «la solidité à toute épreuve» des livres de Flaubert; or c’est par la solidité que valent avant tout ceux de Boylesve: dans un ouvrage littéraire, quel qu’il fût, il n’était rien qu’il estimât autant que la solidité, et c’est à cause d’elle qu’il était demeuré à Flaubert si fidèle. D’autre part, il y a en Boylesve des traces d’un pré-proustisme indéniable (dont il serait fort intéressant de repérer et de suivre les manifestations). Par où s’expliquent et sa résistance à Proust, et l’étendue de son abandon. Les ouvrages post-proustiens de Boylesve ne permettent pas de tout à fait apprécier ce qu’il aurait pu accomplir dans cette voie: comme il en va avec tous les artistes qui ont leurs biens en terres et non en argent liquide, les phases de transition étaient chez lui longues et difficultueuses. Telle que son œuvre nous parvient, je crois que l’avenir retiendra surtout à côté de certains des premiers livres: Mademoiselle Cloque, La Becquée, L’Enfant à la Balustrade,—témoignages français non moins probants que ces portraits de famille qu’Ingres exécutait à la mine de plomb—les deux romans intimes et les deux romans-somme de période médiane.
[E] Bien entendu je prends ici ces mots de «subjectif» et d’«objectif» dans le sens courant, et non point dans leur saine et seule valide acception philosophique. (Je tiens à me prémunir contre les foudres légitimes de mon ami Ramon Fernandez.)
[F] La Touraine, p. 99-101.
[G] L’Enfant à la Balustrade, p. 385-386.
[H] La Touraine, p. 92-94.
[I] La Touraine, p. 94-96.
[J] «Plus nous avançons dans la lecture des Essais, plus nous nous éloignons des exercices un peu rhétoriques du début, plus nous voyons Montaigne soucieux non seulement de se définir, mais encore de se classer: son moi ne remplit pas le cadre, il y a de l’espace autour de lui dans ce noble tableau où tient Épaminondas.» (Ramon Fernandez, Messages p. 155.)
[K] Le besoin d’être jugé, besoin français s’il en est, proche parent du besoin de se juger, qu’il ne faut cependant pas tout à fait confondre avec lui,—le besoin de se juger appartenant en commun, en tout pays et en tout temps, aux hommes qui comptent; le besoin d’être jugé plus particulier, lui, à ceux de notre race,—que le Français y soit porté par l’instinct social si développé en lui, et qui souvent l’incline à un respect du «social» comme tel; ou que, plus profondément, en vertu tout ensemble et de son courage intellectuel et d’un certain scepticisme foncier quand un jugement que l’on peut former sur soi, il tende à révoquer en doute ce jugement tant qu’il n’est pas contresigné par autrui.—Quoi qu’il en soit, ce besoin d’être jugé, Boylesve l’éprouvait au maximum (et en ce sens le fragment de Feuilles tombées que j’ai cité tout à l’heure: «J’aime mieux la forme des choses qu’un visage: elle sait me plaire et elle ne me juge point», s’il correspond à l’état d’exaltation solitaire, n’exprime pas et même trahit l’ossature de sa pensée normale). C’est en fonction de ce besoin d’être jugé que s’explique et que se légitime la considération dans laquelle Boylesve tenait, et voulait que l’on tînt, les manifestations de l’opinion publique. Dans nos longs tête-à-tête, c’était là le sujet où nous prenions parfois ces «positions opposées ou simplement différentes» auxquelles j’ai fait allusion,—le point où il m’était plus facile de le comprendre que de le suivre; mais c’est que je n’avais pas encore su voir dans cette considération pour l’opinion publique ce que trop tard j’y aperçois aujourd’hui: la pointe, la dentelure héroïque du besoin d’être jugé.—A cet égard, comme à maints autres (Mon Amour ne s’inscrit-il pas, en regard de Dominique, comme l’autre volet d’un idéal dyptique?), Boylesve rappelle Fromentin—à qui du reste il ressemblait, au témoignage de Madame Vaudoyer qui avait connu Fromentin, et que frappait à nouveau cette ressemblance tandis que nous regardions ensemble le portrait de Fromentin par Ricard. Dans le chapitre—qui est sans doute le chef-d’œuvre des Maîtres d’autrefois,—le chapitre sur Ruysdaël, ayant à parler du peintre le plus près de son cœur, Fromentin commence par faire à l’opinion publique des concessions si étendues que d’abord il semble que l’on ne voie clairement que les manques de Ruysdaël; mais c’est afin—à la faveur de ces concessions mêmes—d’obtenir gain de cause en ce qui concerne l’intime, l’irremplaçable de son génie. Sans cesse, dans ses jugements, dans ses propos et jusque dans son attitude, Boylesve procédait de la sorte. Abandonner l’inessentiel pour ne jamais transiger sur le noyau: se replier mais pour tenir, là aussi il y a—non plus la pointe ou la dentelure—mais le retrait héroïque d’un autre besoin: celui de sauver l’enjeu central de la partie, de sauver la citadelle.
[L] «Quelle est donc la vertu singulière de l’angoisse chrétienne, pour qu’elle communique à tous les grands esprits qui en sont touchés je ne sais quelle beauté et quelle magnanimité d’âme, ou quelle passion enfin, que n’ont pas tout de même un Socrate, un Montaigne, un Gœthe!»
(Feuilles tombées.)
[M] Mᵐᵉ René Boylesve.
[N] Il s’agit du Bel avenir.
[O] Le Bel Avenir.
[P] Il s’agit de l’héroïne de Mon Amour.